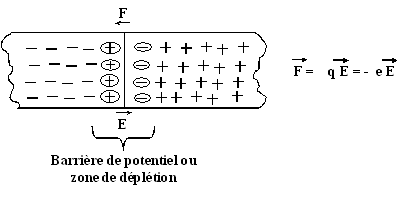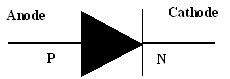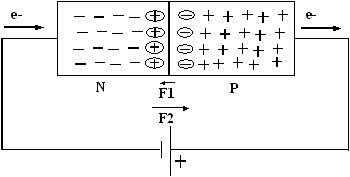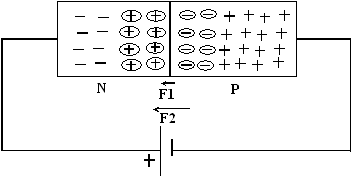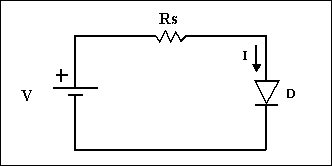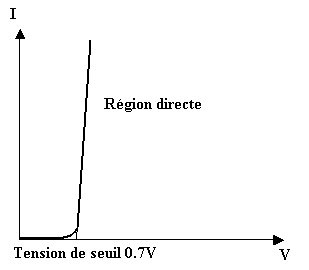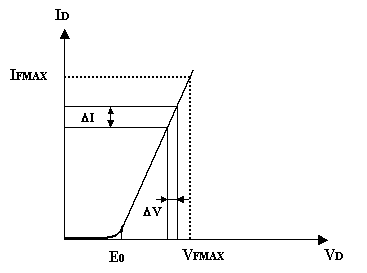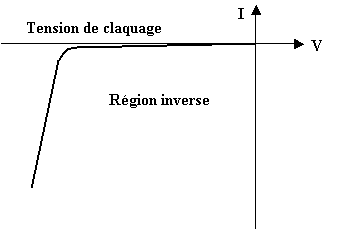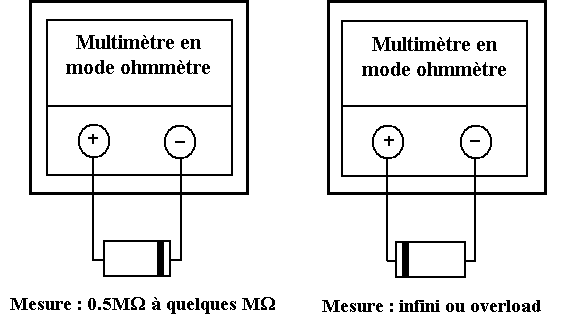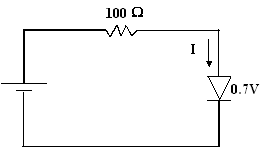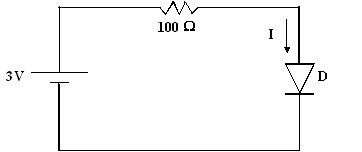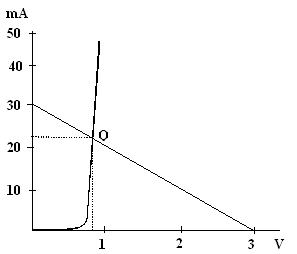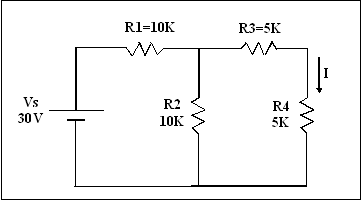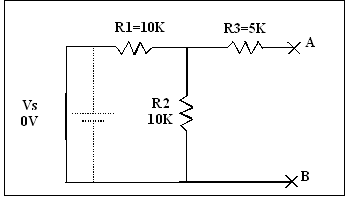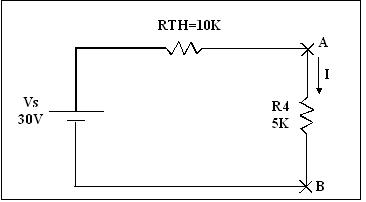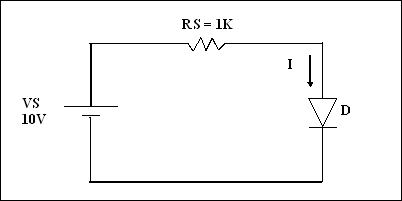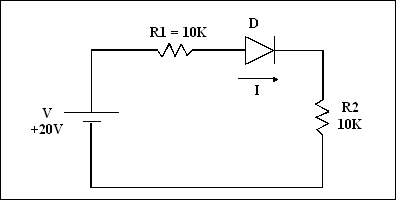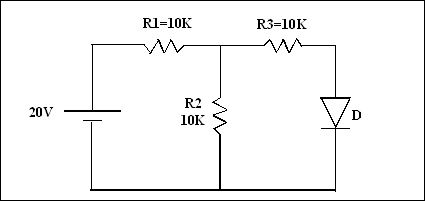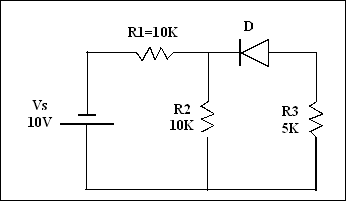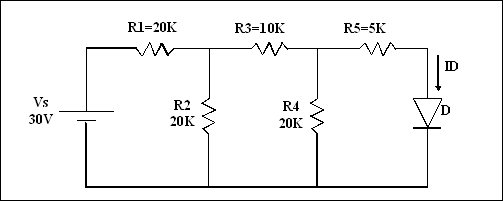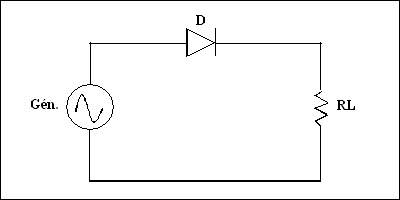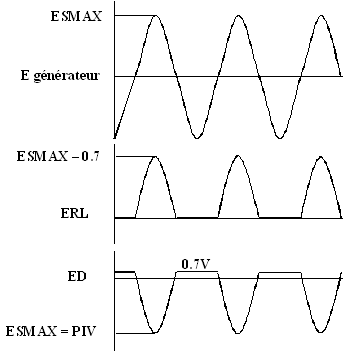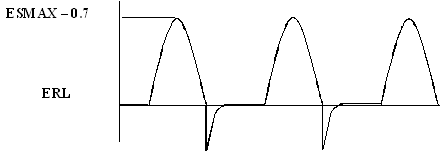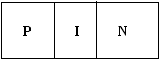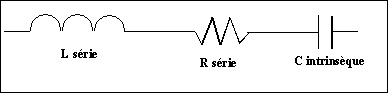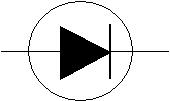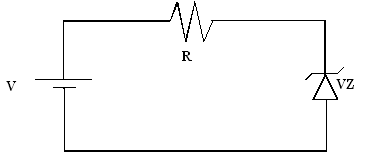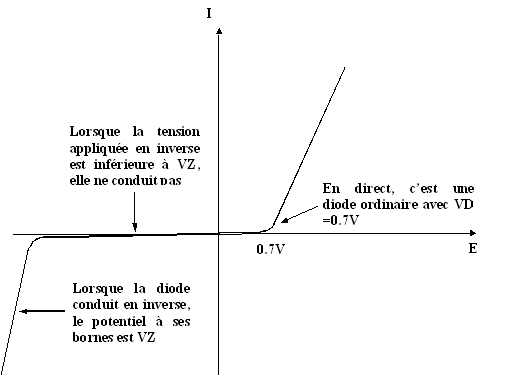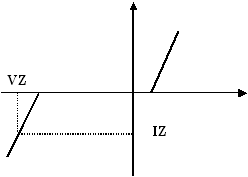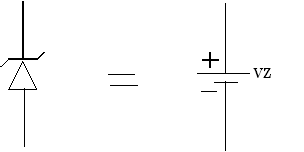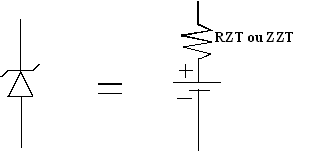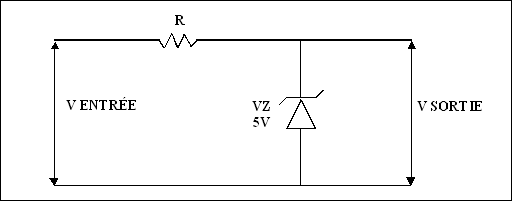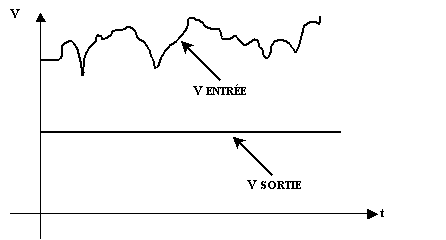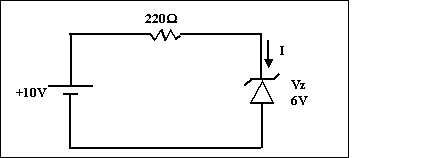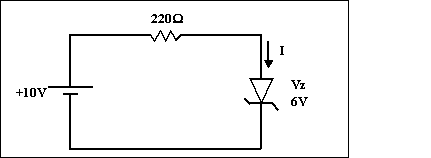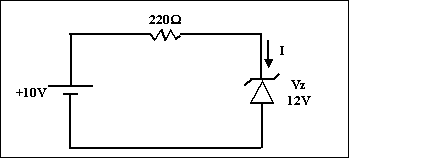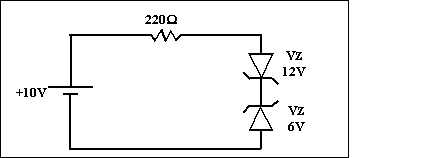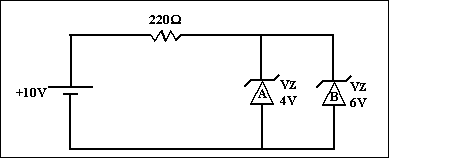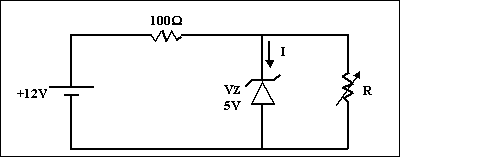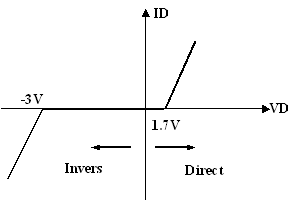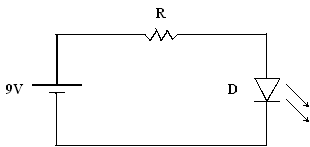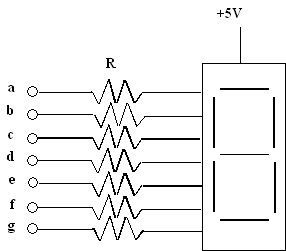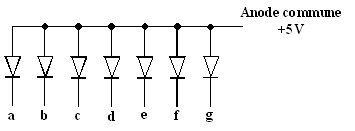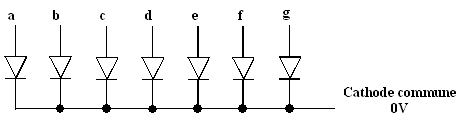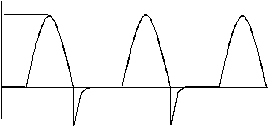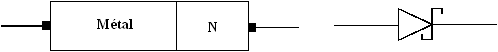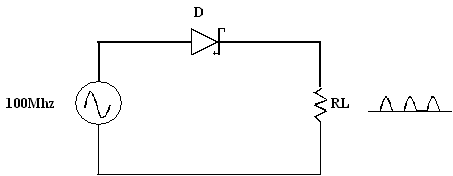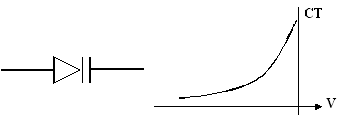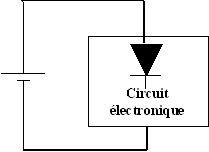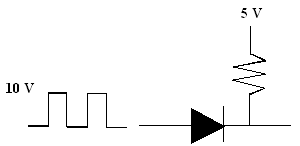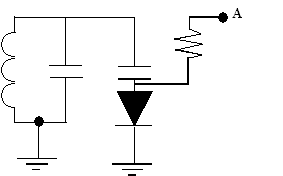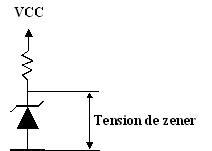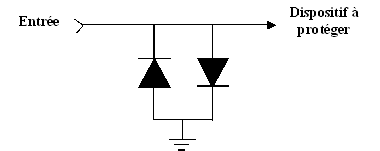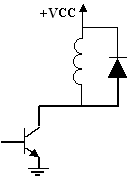Chapitre
2: La
diode
1. La jonction PN
Que se passe-t-il lorsqu’on réunit un matériel
P et un matériel N ensemble ? On obtient la jonction PN
Par
effet de diffusion, les électrons du côté N traversent du côté P et tombent
dans les trous. Les atomes, du côté P, deviennent des ions négatifs (1 électron
en plus). De l’autre côté (N), les atomes perdant un électron deviennent
des ions positifs (1 proton en plus).
Diffusion : c’est le phénomène par
lequel les corps placés en contact se mélangent sans qu’il y ait brassage de
molécules.
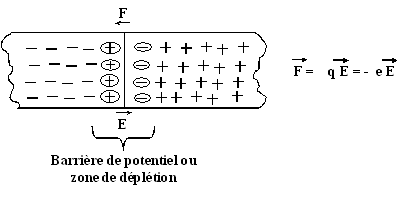
On
a alors autour de la jonction ce qu’on appelle un dipôle. Ce processus va se
continuer jusqu’à ce que le champ électrique créé par le dipôle soit
assez puissant pour empêcher d’autres électrons de traverser la jonction, on
aura alors l’équilibre. Cette barrière de potentiel créée vaut 0.7 volt
pour le silicium.
2. La diode, symbole
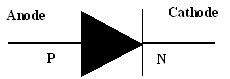
La
diode est constituée d'un barreau de matériau type P accolé à un barreau de
matériau de type N. On remarque immédiatement l'anode et la cathode qui seront
les électrodes de notre composant.
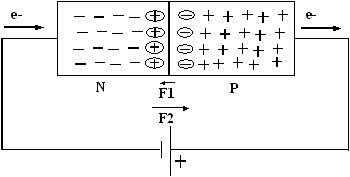
Les
électrons entrent du côté N et pénètrent ensuite dans la zone de déplétion
comme électrons libres en annulant les ions positifs. Ceux qui quittent du côté
P laissent des trous qui atteignent la
zone de déplétion annulant les ions négatifs. À la jonction les électrons
du côté N tombent dans les trous du côté P et atteignent la sortie du bloc P
par courant de trous. La zone de déplétion n’existe donc plus et toute la
diode est conductrice.
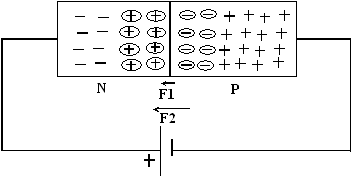
Le champ électrique causé par la
source s’additionne à celui du dipôle. La zone de déplétion s’épaissit
jusqu’à ce que son potentiel soit égal à celui de la source. La zone de déplétion
n’étant pas conductrice, la diode est bloquée, c’est-à-dire qu’aucun
courant ne la traverse.
Voici
le montage. Remarquez que nous avons connecté le + de l'alimentation à l'anode
de la diode et le - par l'intermédiaire de la résistance à la cathode. Ce
branchement provoquera la circulation du courant, on dira que la diode est polarisée
dans le sens passant. Si nous avions adopté
l'autre sens (le + sur la cathode) nous aurions polarisé notre diode en inverse
et aucun courant n'aurait circulé, notre diode aurait
été bloquée et polarisée dans le sens non passant.
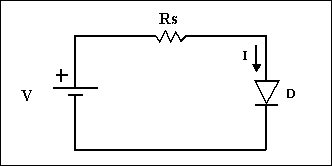
Résistance “chutrice” RS :
RS
est une résistance qui a pour rôle de limiter le courant qui circule dans la
diode. Plus RS est
grande, plus le courant dans la diode est petit. Chaque circuit à diode que
nous étudierons comportera une résistance “chutrice” en série avec la
diode. La résistance RS sera choisie de façon à garder
le courant direct inférieur au courant limite de la diode.
Pour
notre expérience, nous allons faire varier la tension du générateur de 0 à +
VCC
(nouveau terme indiquant la tension maximum d'alimentation continue) en relevant
à chaque fois le courant qui circule dans le circuit et la tension aux bornes
de la diode. Une fois ceci effectué, nous inverserons les pôles du générateur
et prendrons des mesures de la même façon que précédemment. Ces relevés
nous permettrons d'établir graphiquement les caractéristiques tension versus
courant de la diode.
-
Dans la région directe, quand la
tension aux bornes de la diode est inférieure à 0,7 V, aucun courant ne
circule dans le circuit, c'est comme si nous avions un interrupteur ouvert. À
0,7 V, brutalement le courant apparaît. Si nous augmentons la valeur de la
tension fournie par le générateur, la tension aux bornes de la diode reste
sensiblement constante et égale à 0,7 V.
D'ailleurs on appellera cette tension, la tension
de seuil, c'est explicite. Cette tension de seuil est de 0,7 V pour le silicium
et 0,2 à 0,3 V pour le germanium.
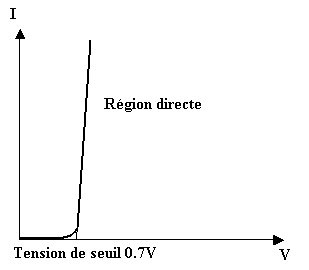
Lorsqu’on tend vers la barrière de
potentiel (0.7 volt pour le silicium), de nombreux électrons libres et trous
commencent à traverser la jonction et le courant augmente fortement. Au-delà
de 0.7 volt, une petite variation de tension produit une forte augmentation de
courant. On est alors au coude de la diode. La valeur pratique de cette tension
de seuil ou de coude est l’abscisse E0 du point d’intersection de l’axe
des tensions et du prolongement de la partie rectiligne de la caractéristique.
Résistance
directe :
Nous
l'avons déjà dit, la diode n'est pas un élément linéaire aussi définit-on
sa résistance statique. Celle-ci sera égale au quotient V/I. Si l'on regarde
la caractéristique plus haut, il apparaît clairement que si l'on se déplace
sur la courbe et que l'on choisisse un autre point le quotient V/I donnera une
autre valeur. La résistance statique est donc dépendante du point de
fonctionnement de la diode. On définit par ailleurs une résistance dynamique
qui prend en compte l'excursion sur la caractéristique de la diode. Pour
calculer cette résistance dynamique, on choisit deux points et l'on calcule le
quotient qui sera de la forme :
DV
Rd
= ---------
DI
Cette
résistance interne de la diode est appelée “résistance extrinsèque” ou
“bulk” en anglais.
Pour
éviter la destruction de la diode, il faut respecter sa tension maximale et son
courant maximal notés respectivement VFMAX
et IFMAX (F = Forward). VFMAX
est aussi appelé VBR
(Voltage break down) ou BV (Breakdown Voltage).
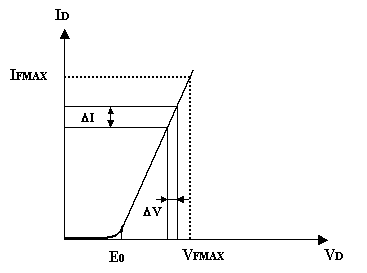
-
Passons
dans la région inverse. Nous constatons que la diode, polarisée en inverse ne
conduit pas et donc qu'aucun courant ne circule dans le circuit hormis un léger
courant de fuite de quelques µA que l'on pourra négliger (en inverse une diode
se comporte comme un circuit ouvert). Brutalement, la diode, toujours polarisée
en inverse se met à conduire et le courant circule. La tension à partir de
laquelle une diode polarisée en inverse conduit s'appelle la tension de
claquage. Ce claquage n’est pas destructif si la température maximale de la
jonction n’est pas atteinte (c’est le cas des diodes “zener” que nous étudierons
plus loin).
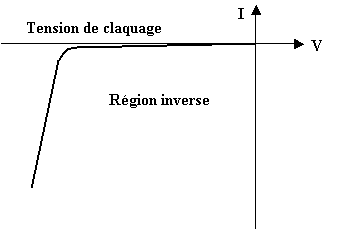
La caractéristique inverse ID
versus V permet de définir :
a)
La tension inverse maximale (Vi max = PIV = PRV)
PIV =
Peak Inverse Voltage
PRV =
Peak Reverse Voltage
C’est
la valeur maximale de V qu’il ne faut pas dépasser.
b)
Résistance inverse : c’est le quotient DV
/ DI,
DV
et DI
étant pris sur la portion de la caractéristique comprise entre 0 et VZ
(tension de claquage).
Exemple :
Pour
la diode 1N4005
IFMAX =1 A
VFMAX = 0.8 V à 1 A
PRV
= 600 V
Pour
la diode 1N4148
IFMAX =200 mA
VFMAX = 1 V à 10 mA
PRV
= 100 V
Ce qu'il faut retenir :
La diode
au silicium, polarisée dans le sens passant conduit dès que la tension à ses
bornes est supérieure ou égale à 0,7V
La diode
polarisée en inverse ne conduit pas et se comporte comme un interrupteur ouvert
jusqu'à la tension de claquage.
3. Vérification de la diode à l'aide du multimètre
L'objectif
est d'utiliser convenablement le multimètre pour identifier l'anode et la cathode
d'une diode.
En utilisant le
multimètre en mode ohmmètre, on mesure la conduction de la diode en direct et
en inverse.
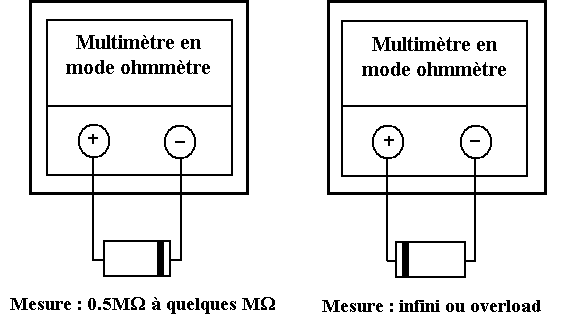
Sur le multimètre que vous utilisez, vous remarquerez le symbole de la
diode. On place le sélecteur de fonction à cette position et on refait les
mesures précédentes :
Mesure: 0,57 à 0,78 Volt
Mesure : Infini ou OverLoad
Nota : Les valeurs en direct sont variables selon le type de diode
(redressement, logique ou zener).
Regardez le
schéma ci-dessous. Quel est le courant qui circule dans ce circuit ?
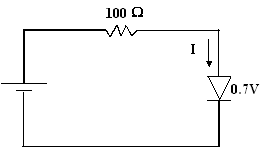
Appliquons la
loi d'Ohm pour la résistance, il vient :
V
10 - 0,7
I
= -------- I
= ------------ = 0.093 A
R
100
- Introduction à la
notion de point de fonctionnement et de droite de charge :
La droite de charge est un outil
permettant de calculer le courant et la tension exacts de la diode. Cette notion
nous sera utile pour l'étude des transistors.
Reprenons notre montage de tout à l'heure,
mais avec des valeurs différentes. Sans faire de calcul, nous pouvons
graphiquement arriver au même point en traçant la droite de charge de
notre diode.
Si nous désirons
connaître le courant qui circule dans ce circuit, posons l'équation du
courant.
VCC
–VD
I
= -------------------
R
Cette équation
est une relation linéaire entre le courant et la tension. Sa représentation
graphique est une droite. C'est l'équation de la droite de charge.
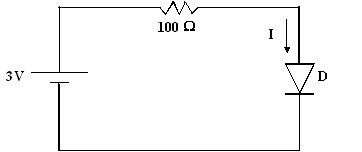
Maintenant appliquons cela à notre circuit. Pour tracer la droite de
charge, nous prendrons 2 hypothèses.
La 1ère est que la tension VD
de la diode = 0 (diode en court-circuit) ce qui nous donnera :
3
– 0
I
= --------------- = 0.03A. Ce point se caractérisera par V = 0 et I = 0.03A
100
Et la 2ème que la tension VD
égale la tension d'alimentation de 3V (diode en circuit ouvert),
ce qui donnera :
3
– 3
I
= ------------- = 0. Ce point se caractérisera
par V = 3V et I = 0
100
Nous avons deux points, c'est suffisant pour tracer la droite de charge
sur la caractéristique de la diode. Le point de croisement des deux courbes
représente le courant et la tension de la diode pour une tension de 3 volts et
une résistance chutrice de 100 W.
On appelle ce point “point de fonctionnement de la diode”. Il est noté
Q.
Pour notre exemple, le point Q de fonctionnement de la diode a pour
caractéristiques V = 0.7V et I = 23mA.
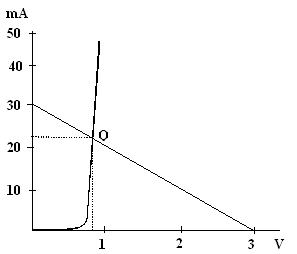
- Les caractéristiques
essentielles :
Les diodes
ont, comme on peut s'en douter, une flopée de caractéristiques. Tout ceci
n'est pas toujours simple à lire ou à retenir. Sachons toutefois voir
l'essentiel dans les données des constructeurs.
Tout ce qui
est indicé “f” (forward) signifie direct, donc sens passant
Tout ce qui
est indicé “r” (reverse) signifie inverse, donc sens non passant.
VF : tension directe
continue
VFM : tension directe de crête
VR : tension inverse continue
VRM : tension inverse de crête
IF
: courant direct continu
IFM : courant direct de crête
Soyez
vigilant aux paramètres inverses plus particulièrement pour les alimentations
haute tension. Les diodes comme tout composant ont des limites qu'il convient de
respecter sous peine de les détruire !
Sur le
plan pratique :
Si vous avez un doute à propos d’une diode, vous pouvez savoir
rapidement si elle est bonne ou pas. Prenez votre contrôleur universel (C'est
le premier instrument que vous devez acquérir), mettez-le en position
“diode” et appliquez les pointes de touche sur les bornes de votre diode.
Relevez l'indication et inversez les pointes de touche. Si la diode est bonne,
une mesure a du vous indiquer une valeur (en général 0.57 à 0.78V) et l'autre
mesure l'infini.
Exercice 1 :
En utilisant deux méthodes différentes, calculer le
courant circulant dans la résistance R4
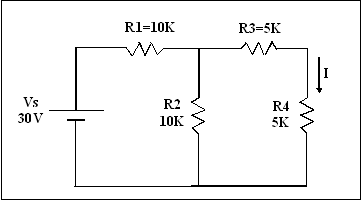
1o
Courant total IT ?
RT =
((R3 + R4)
// R2) + R1
= 5 K + 10 K = 15 K
IT
= VS / RT = 30 V/ 15 K = 2 mA
VR2
= VS – VR1
= 30 V – 10 K x 2 mA = 30 – 20 = 10 V
I
= VR2
/ (R3 + R4)
= 10 / (5K + 5K) = 10 / 10 K = 1 mA
2o
RTH ? ETH
?
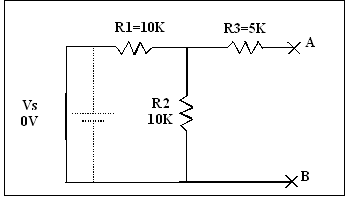
RTH
= (R1 // R2)
+ R3 = 5 K + 5 K = 10 K
ETH
= (VS / (R1
+ R2)) x R2
= (30 / 20 K) x 10 K = 15 V
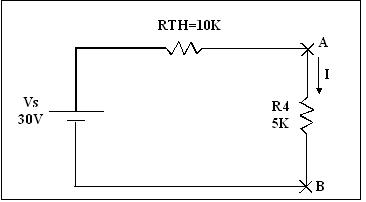
I
= ETH
/ (RTH +
R4)
= 15 / (10 K + 5 K) 15 / 15 K = 1 mA
Exercice 2 :
Calculer le courant qui circule dans la diode du
circuit suivant :
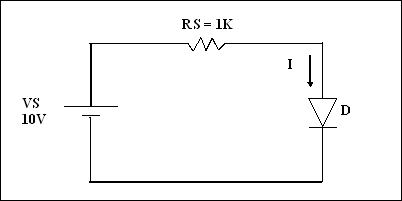
I
= (VS
– VD) / RS
= (10 – 0.7) / 1 K = 9.3 mA
Exercice 3 :
Calculer le courant qui circule dans le circuit suivant
:
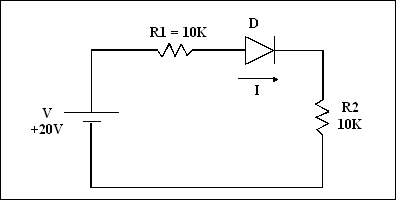
I
= (VS
– VD) / (R1
+ R2) = (20 – 0.7) / 20 K = 965 mA
Exercice 4 :
Calculer le courant I dans la diode D.
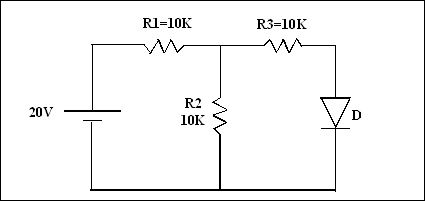
RTH
= 15 K
ETH
= 10 V
ID =
(ETH
– VD)
/ RTH
= (10 – 0.7) / 15 K = 620 mA
Exercice 5 :
Calculer le courant ID du circuit suivant :
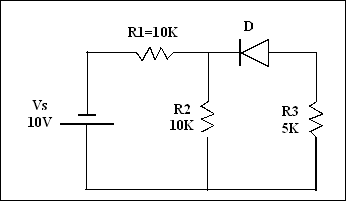
RTH
= 10 K
ETH
= - 5 V
ID =
(ETH
– VD)
/ RTH
= (5 – 0.7) / 10 K = 430 mA
Exercice 6 :
Trouver la valeur du courant ID du
circuit suivant :
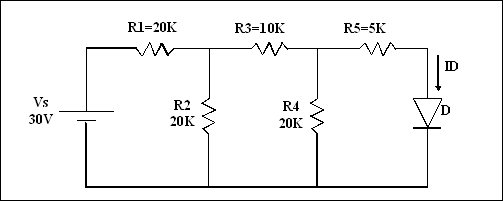
RTH
= 15 K
ETH
= 7.5 V
ID =
(ETH
– VD)
/ RTH
= (7.5 – 0.7) / 15 K = 453 mA
4. Les autres diodes
a)
Diode de redressement
Un circuit
redresseur transforme une tension alternative en une tension continue pulsée.
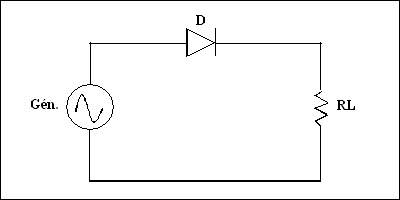
D ne laissera passer que le courant causé par
l’alternance positive du générateur alternatif (AC). On retrouve dans ce
circuit les formes d’ondes suivantes :
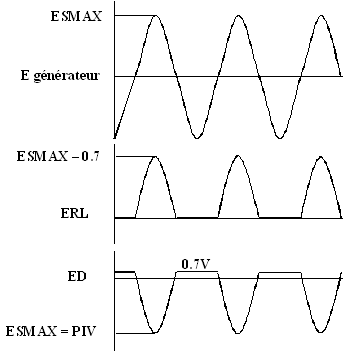
Lors de l’alternance positive du générateur AC, la diode se trouvant
polarisée en direct laisse passer un courant dans la charge RL.
La valeur de la tension maximale aux bornes de RL
sera la tension de crête du générateur moins la barrière de potentiel de 0.7
volt de la jonction de la diode. Tout le temps que dure l’alternance positive
du générateur, la diode est en direct et chute 0.7V. Lors de l’alternance négative,
la diode se trouve en inverse, bloque et agit comme un circuit ouvert récoltant
toute la tension du générateur AC à ses bornes et aucun courant ne traverse RL.
Remarque : ce qu’on vient de dire est vrai seulement aux basses fréquences
inférieures à 600 Hz (F < 600Hz). Si F est plus grand, la diode ne bloque
plus totalement l’alternance négative.
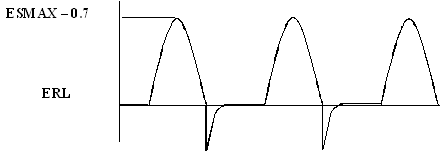
Les différentes
bandent d’énergie proches de la jonction stockent temporairement la charge
d’une diode polarisée en direct. Plus le courant direct est grand, plus la
charge accumulée est grande. Ce phénomène est appelé “accumulation de
stockage” ou “stockage de charge”.
Si on
polarise brusquement la diode en inverse, les porteurs de charge stockés
circulent dans le sens inverse durant un petit laps de temps.
Le temps que prend la diode pour se bloquer s’appelle temps de récupération
inverse, de déstockage ou de recouvrement.
Les diodes de redressement comme la 1N4001 – 1N4007 ne sont pas utilisées
à des fréquences supérieures à 600 Hz.
b) La diode PIN (P – Intrinsèque –N) : la diode PIN est constituée
de trois régions : une région P et une région N séparées par une région
I à haute résistivité.
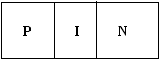
La diode PIN est équivalente à un circuit RLC série
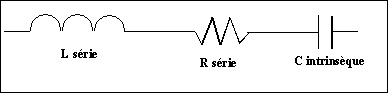
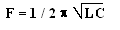
La
région I permet de diminuer la capacité de la jonction (voir condensateur), ce
qui favorise l’utilisation de cette diode aux hautes fréquences.
Symbole
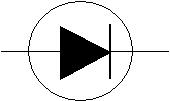
Sur
les schémas, elle est souvent symbolisée comme une diode normale.
c) La diode Zener : c'est une diode conçue pour
fonctionner en inverse. Il faut placer une résistance en série pour limiter le
courant et ne pas détruire la diode. Le symbole de la zener est :
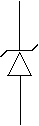
La
diode zener a une tension d’avalanche (VRMAX)
basse et on met à profit cette caractéristique. Lorsque la tension
d’avalanche est atteinte, le courant en inverse (IR)
augmente mais une variation de IR
même importante n’occasionne qu’une variation faible de VZ ou VR.
La diode ne se détruit pas à cause de la tension basse qui n’occasionne pas
un échauffement excessif de la diode.
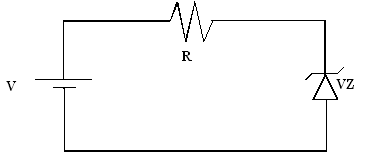
Sa courbe I en fonction
de E est :
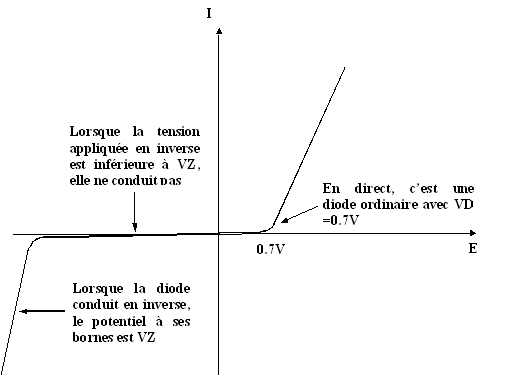
Caractéristiques
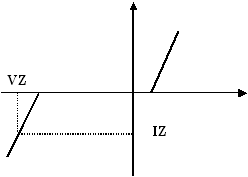
IZT
= I ZENER TEST
= c’est le courant qui traverse la diode quand la puissance dissipée par
celle-ci est le quart de sa puissance maximale (P = PMAX / 4)
VZT
= Tension aux bornes de la zener à IZT
Diode zener idéale
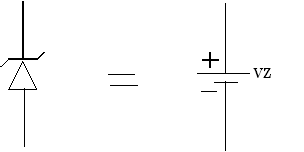
Diode zener réelle
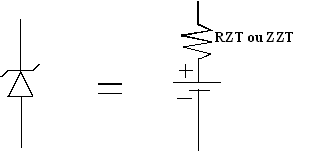
Une
résistance zener (relativement petite) est en série avec une batterie idéale.
La chute de tension aux bornes de la résistance interne de la diode augmente
avec le courant mais cette chute reste relativement faible.
Donc
quel que soit le courant, la tension VZ est
pratiquement constante et c’est cette particularité qui fait que cette diode
est employée comme régulateur de tension.
Exemple : régulateur de
tension à diode zener
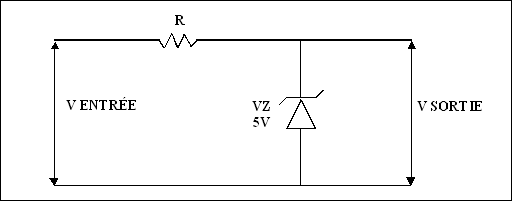
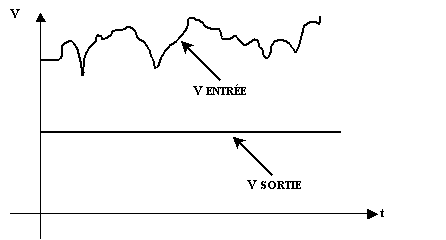
Tant
que la tension d’entrée est supérieure à 5 volts, la zener conduit et la
tension de sortie est constante à 5 volts. On dit que la tension de sortie est
régularisée.
Exercice
1 :
Calculer le courant dans la
zener et la puissance dissipée par celle-ci :
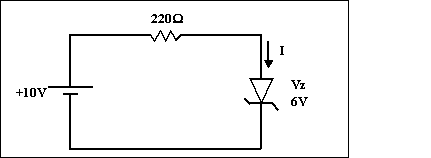
Exercice 3 :
Calculer le
courant dans la zener et la puissance dissipée par celle-ci :
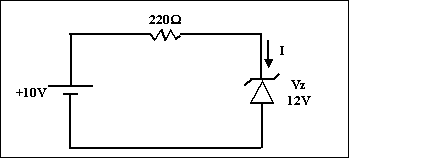
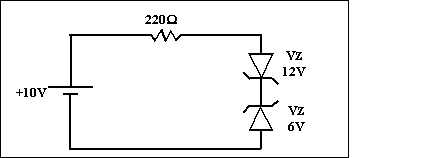
Exercice 5 :
Calculer le
courant dans les “zeners” et les puissances dissipées par celles-ci :
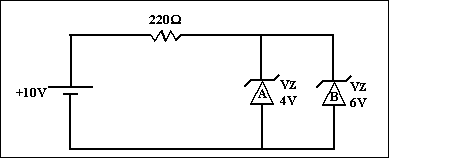
Exercice 6 :
Calculer
IZ
pour R = infini, 1 KW,
100 W et
50 W
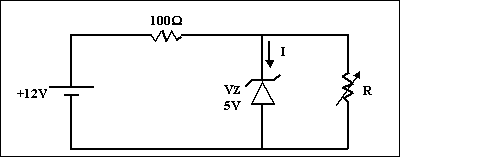
Solution
§
Pour RL
= infini, tout le courant passe par la zener
IRS = (12 – 5) / 100 = 70 mA
§
Pour RL
= 1 KW, le courant se divise entre
la zener et la résistance de charge. On est certain qu’il y a du courant dans
RL car elle conduit peu importe la tension
appliquée. Par contre, on n’est pas certain qu’il y a un courant dans la
zener car si la tension est inférieure à 5 volts, elle ne conduit pas. Puisque
ce circuit est un régulateur de tension à 5 volts, il est logique de supposer
que la diode zener conduit et qu’elle maintient la tension constante à 5
volts.
VZ
= 5 V
IRS
= (12 V -5 V) / 100 W = 70 mA
Ce courant
se partage entre la zener et RL
IRL = 5 V / 1 KW
= 5 mA
IZ
= 70 mA – 5 mA = 65 mA
§
Pour RL
= 100 W, on refait la même
supposition, VZ = 5 volts et le courant
total est de 70 mA
IRL = 5 V / 100 W
= 50 mA
IZ = 70 mA – 50 mA = 20 mA
§
RL
= 50 W, si on refait la même
supposition, on obtient encore un courant total de 70 mA alors que la résistance
consomme
IRL
= 5 V / 50 W = 100 mA
C’est
impossible car le courant total disponible est de 70 mA. La seule solution est
que la zener ne conduit pas è
IZ = 0
Le courant réel
dans le circuit est
IRL
= IRS = 12 / (RL
+ RS) = 12 / 150 = 80 mA
VRL =
50 x 80 mA = 4 volts
d)
La diode électroluminescente (LED ou
DEL)
Vous la connaissez
bien, on en voit partout. Retenez qu'une DEL ou LED en anglais fonctionne avec
un courant d'une dizaine de mA.
Symbole

Principe
Les
électrons libres d’une diode polarisée en direct traversent la jonction et
se recombinent avec des trous. Lorsque les électrons tombent dans les trous,
ils émettent de l’énergie, une parie en chaleur, une partie en lumière.
Dans
le cas des diodes électroluminescentes, c’est le deuxième cas qui est
exploité.
On
retrouve les Leds dans les applications dites “optoélectroniques” comme par
exemple un témoin lumineux ou un afficheur numérique.
Les
diodes ordinaires sont au silicium, une substance opaque qui bloque le passage
de la lumière. Les Leds sont différentes : elles comportent du gallium,
de l’arsenic et du phosphore, des substances qui rayonnent du rouge, du vert,
du jaune, du bleu, de l’orange et de l’infrarouge (invisible).
Les
Leds à infrarouge sont utilisées dans les systèmes d’alarme et de télécommande.
Caractéristiques :
la Led est utilisée en direct. La chute de tension type entre les bornes
d’une Led varie de 1.5 V à 4 V pour des courants variant de 10 mA à 50 mA.
La chute de tension exacte dépend du courant, de la couleur, de la tolérance
etc.
Tension de seuil
des Leds en fonction de la couleur :
Rouge
~ 1,6 V à 2,5 V
Jaune
~ 2 V
Vert
~ 2V
Bleue
~ 4V
Sauf
indication contraire, utiliser une chute de tension nominale de 1.7 volts, un
courant de 15 mA pour dépanner et analyser les circuits à Leds.
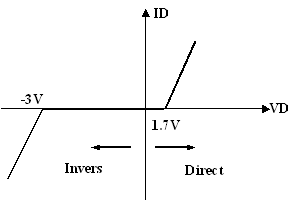
Calcul de la résistance
de branchement
Nous possédons une LED verte dans laquelle nous
souhaitons faire circuler un courant de 10 mA, la tension d'alimentation est
fournie par une pile de 9 V. Quelle est la valeur de la résistance à mettre en
série ?
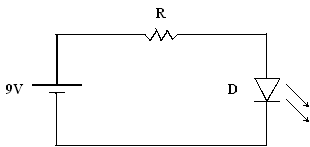
Nous savons que la
tension de seuil d'une LED verte avoisine les 2V et que le courant circulant
dans ce circuit doit être de 10 mA. D'autre part la loi d'Ohm nous dit que R=
V/I, il suffit d'appliquer cette loi pour obtenir :
R
= V/I
R
= (9 - 2) / 0.01
R
= 700 W
Afficheur sept segments
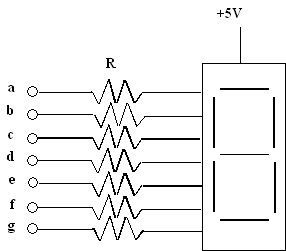
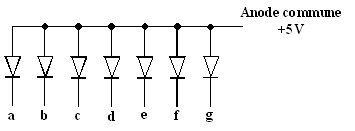
§
Afficheur « cathode commune »
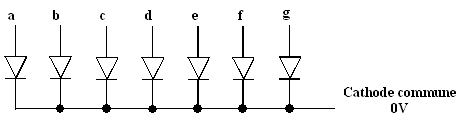
e)
La diode Schottky
Fréquemment utilisée
en hautes fréquences comme mélangeuse entre autres, cette diode à un seuil de
tension très bas (0.25V) et commute très rapidement les signaux. Les Schottky
de puissance sont également utilisées dans les alimentations.
Signal obtenu à
l’aide d’un redresseur demi-onde à haute fréquence
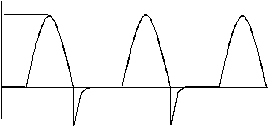
Les pointes négatives
sont dues au stockage de charge durant la conduction de la diode.
Quel est le remède
au temps de récupération inverse des diodes de redressement ? Une diode
Schottky. Un côté de la jonction de cette diode à usage spécial est
en or, argent ou platine et l'autre est en silicium dopé type N (voir figure
ci-dessous). Les orbites des électrons libres du côté N d'une diode
Schottky non polarisée sont plus petites que celles des électrons libres du côté
du métal. Cette différence des orbites s'appelle la barrière de Schottky.
Si la diode est
polarisée en direct, les électrons libres du côté N acquièrent assez
d'énergie pour circuler sur de plus grandes orbites. Donc, les électrons
libres traversent la jonction et pénètrent dans le métal, ce qui produit un
grand courant direct. Comme il n'y a pas de trous dans le métal, il n'y a pas
stockage de charge ni de temps de récupération inverse.
La figure
ci-dessous représente le symbole graphique d'une diode Schottky. Pour s'en
souvenir, remarquer que les traits forment un S rectangulaire. En raison de
l'absence de stockage de charge, une diode Schottky se bloque plus rapidement
qu'une diode ordinaire. Une diode Schottky redresse facilement des fréquences
à 300 Mhz
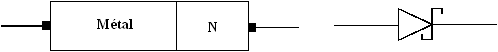
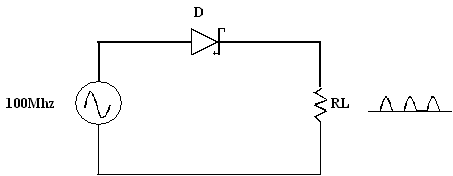
f)
La diode Varicap
Comme
son nom l'indique, cette diode présente une capacité variable en fonction de
la tension qui est appliquée à ses bornes. On l'utilise dans les oscillateurs
commandés en tension (VCO) ou dans les circuits accordés. Vous la retrouverez
souvent en hautes fréquences.
La diode varicap est une diode au silicium optimisée
pour cette propriété. Comme la tension commande la capacité, elle remplace le
condensateur accordé mécaniquement dans de
nombreuses applications (télévision, radio etc.)
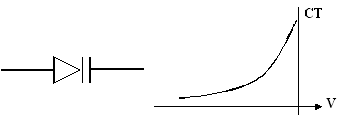
Les
fiches signalétiques des diodes à capacité variable donnent la capacité de référence
mesurée à une tension inverse particulière, ordinairement –4V. La capacité
de référence donnée par la fiche d’une diode 1N5139 (NTE), par exemple est
de 6.8 pF à –4V avec un ratio de 2.7 et un VBR de 30 volts. (CT = 2.5 pF à 6.8 pF).
g)
Les diodes Gunn
Utilisée
en hyperfréquence, leurs caractéristiques leur permettent de se comporter en
oscillateur - mélangeur. Elles ne sont plus guère employées pour cette
application. On en retrouve dans les chaînes multiplicatrices hyperfréquences.
5. Quels usages pour les diodes ?
Au fait, que peut-on en faire ? Voici
quelques exemples, c'est loin d'être exhaustif :
Protéger
un appareil d'une inversion de polarité
La cause de
mortalité précoce des “transceivers” est l'inversion de polarité. Un
instant de distraction et vos économies partent en fumée. La PREVENTION
INTELLIGENTE consiste à mettre une diode en série dans l'alimentation. La
diode sera intégrée dans l'appareil à protéger naturellement.
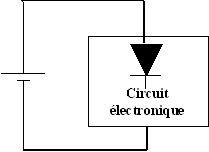
Utilisation en
limiteur
Vous
avez des créneaux de tension de 10 V que vous voulez réduire à une amplitude
proche de 5 V. Voici une méthode simple : Vous aurez en sortie des créneaux
allant de 5 V à 9.3 V d'amplitude soit une excursion de 4,3 V
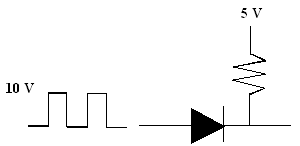
La diode comme
commutateur
Vous
avez réalisé un oscillateur haute fréquence et vous souhaitez, de manière
simple, pouvoir ajouter à ce circuit une capacité de façon à changer sa fréquence
d'oscillation.
Il suffit d'appliquer une tension positive au
point A, la diode conduira, la capacité retrouvera la masse par la diode et
viendra s'ajouter à la capacité totale du circuit
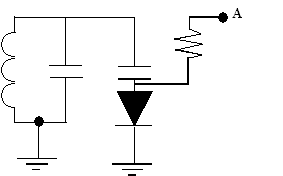
La diode comme
stabilisateur de tension
Nous ferons appel à une diode spéciale appelée diode Zener. Remarquez que
cette diode se polarise en inverse pour exploiter la tension de claquage. Les
“zener” standards ne fournissent qu'une puissance très faible 1 à 2 W.
Toutes ces notions seront abordées ultérieurement.
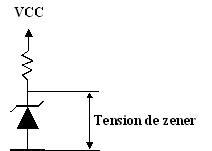
La diode
en écrêteur
Ces deux diodes, montées "tête-bêche"
ou "antiparallèles" seront placées en amont d'un dispositif à protéger
comme par exemple l'entrée d'un transistor amplificateur. Dès que la tension
d'entrée dépassera la tension de seuil des diodes, celles-ci conduiront et dériveront
à la masse l'excédent de tension. L'entrée du transistor verra au maximum la
tension de seuil, soit 0,7 pour du silicium.
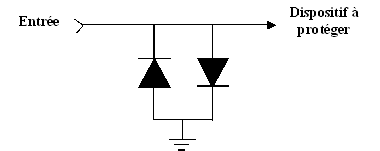
La
diode en protection
Voici un transistor commandant une bobine de
relais. Supposons la diode absente, le montage fonctionne tout aussi bien. Quand
la base du transistor est commandée par une tension adéquate, le transistor se
sature, un courant IC circule dans la bobine et
le relais colle. Inversement quand la tension de commande disparaît, la bobine
va restituer une tension inverse au transistor (loi de Lenz) qui peut avoir des
effets destructifs. La diode est chargée de court-circuiter cette tension
inverse.
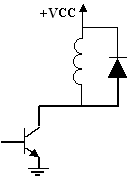
La diode à semi-conducteur
est un élément très employé dans nos circuits et nous la retrouverons dans
presque tous les cours.