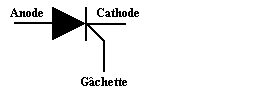
Chapitre 12: Les thyristors
1.
Le redresseur commandé au silicium (SCR)
L’abrégé
“SCR” -en Anglo-saxon Silicon Controlled Rectifier-, redresseur commandé au
silicium, est un commutateur de puissance rapide. Il peut fonctionner sous
plusieurs centaines de volts et conduire des courants pouvant dépasser cent Ampères.
Il remplace le relais et le commutateur mécanique et offre une fiabilité bien
supérieure à ces composants maintenant démodés. Le domaine des SCR recouvre
la commande en alternatif des éclairages, des appareils de chauffage, des
moteurs électriques, etc.
L'utilisation de ces dispositifs s'est généralisée ; il est important d'en comprendre le fonctionnement.
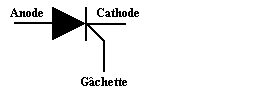
Le SCR consiste en un sandwich de quatre couches de silicium. Le symbole représentatif est celui d'une diode, avec une électrode de commande “GRILLE” ou “G Â C H E T T E”.
Son circuit équivalent est le
suivant :
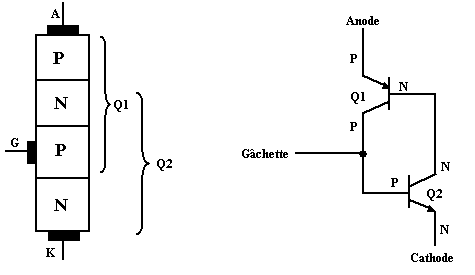
Le thyristor peut être bloqué ou passant (résistance faible) suivant
la tension appliquée à la gâchette, sous forme d'une impulsion de faible
puissance et de courte durée.
Le
fonctionnement peut s'analyser suivant trois configurations différentes :
a)
Polarisation inverse : anode négative par rapport à la cathode. Seul un faible
courant de fuite passe, les jonctions sont polarisées en inverse.
b)
Polarisation directe : anode positive par rapport à la cathode sans
signal de gâchette. Le SCR est dit “bloqué” en direct, il agit
comme une résistance très élevée.
a) Polarisation directe avec un signal sur la gâchette : le SCR débloque la jonction en quelques microsecondes et un courant très important, seulement limité par la résistance externe du circuit, circule dans le SCR. La tension anode cathode reste de l’ordre de 0,5 à 0,7 volt.
Le SCR reste dans cet état conducteur même
après la disparition du signal de commande sur la gâchette. On ne peut le
couper qu’en réduisant le courant qu’il débite en dessous d’une valeur
appelée courant de maintien.
Quand la
conduction s’opérera nous appellerons cette phase “l’amorçage”.
Le SCR présente plusieurs conditions d’amorçage et de désamorçage.
Circuits
d’amorçage en courant continu
Normalement,
l’amorçage du thyristor a lieu si un courant approprié circule dans la gâchette.
Ce courant peut être injecté par l’un ou l’autre des procédés de la
figure # 221.
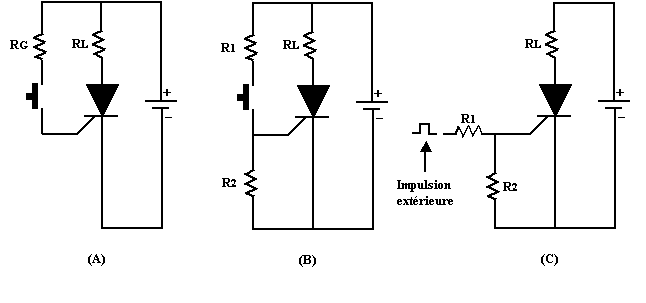
Le
circuit A est le plus simple. On place entre l’alimentation et la gâchette,
une résistance dont la valeur fixe le courant IG
à une intensité adéquate. L’interrupteur amorce le SCR.
Le
circuit B utilise un diviseur de tension qui applique à la gâchette une
fraction de la tension principale. La valeur de ce potentiel doit être
suffisante pour polariser la gâchette du SCR. On la fixe aux environs de 0.6 à
0.8 volt.
Enfin
le SCR du circuit C n’utilise pas d’interrupteur car il reçoit ses
impulsions de déclenchement d’un autre circuit constitué de transistors
bipolaires. Les résistances R1 et R2 forment encore ici un diviseur de tension
qui ajuste la tension de gâchette à la bonne valeur.
Désamorçage
d’un SCR
Même
s’il se compare à un relais électromagnétique, le SCR se distingue d’une
façon marquante sur un point : le courant de commande qui l’a amorcé
via la gâchette, ne peut le remettre à son état bloqué. En effet, si
l’impulsion de courant IG disparaît, après amorçage, le SCR continue de
conduire. Pourtant il faudra bien le désamorcer quand viendra le besoin. Aussi
faut-il prévoir un circuit extérieur apte à accomplir cette fonction
importante.
Les
méthodes de désamorçage sont multiples. En voici quelques-unes (voir
figure # 222):
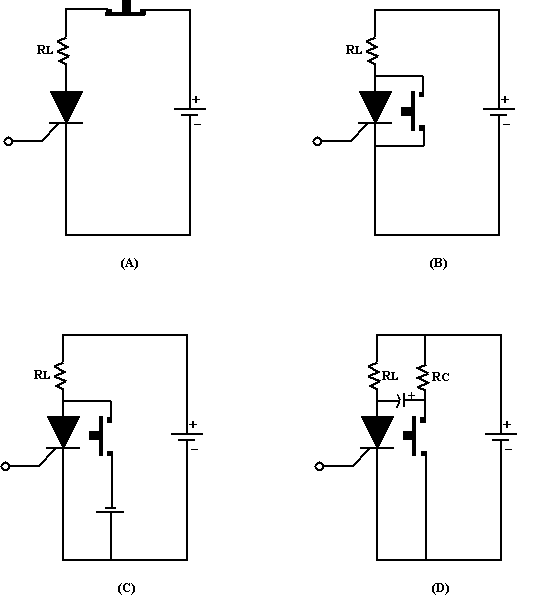
Test
de fonctionnement
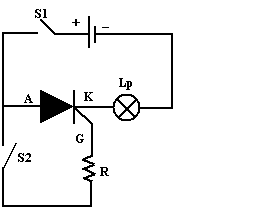
On
trouve une source d’alimentation continue qui peut être une batterie, un
interrupteur S1 qui ouvre ou ferme ce circuit. Le SCR est monté en série avec
une charge constituée par une ampoule.
Le
SCR est polarisé en direct, l’anode au pôle positif et la cathode au pôle négatif
de l’alimentation. La gâchette quant à elle est reliée par l’intermédiaire
d’une résistance R et d’un interrupteur S2 au plus de l’alimentation.
Fermons
S1, il ne se produit rien, la lampe n’allume pas et l’on retrouve la tension
d’alimentation aux bornes du SCR. Laissons S1 fermé et fermons maintenant S2.
La lampe s’allume (VAK
est d’environ 1 volt). Si nous ouvrons
S2, la lampe reste allumée. Pour l’éteindre, nous n’avons pas d’autre
solution que d’ouvrir S1, c'est-à-dire couper l’alimentation.
Interprétation :
-
Fermer le circuit d’alimentation ne
provoque pas la conduction du SCR, là le comportement diffère notablement
d’une diode.
-
Pour provoquer la conduction, nous
devons envoyer une impulsion de courant dans la gâchette du SCR, la tension
doit être positive par rapport à la cathode. Nous avons amorcé notre SCR.
-
Si nous inversons les polarités de
l’alimentation, le SCR ne s’amorce plus, il a donc un comportement polarisé.
-
Pour bloquer le SCR, il faut ramener la
ddp anode cathode à une valeur nulle ou presque.
Conditions d’amorçage
Les conditions de blocage
|
-
Tension anode-cathode positive
et supérieure au seuil mini (voir notice du constructeur) -
courant de gâchette IG
supérieur à la valeur minimale requise (dépendante du thyristor) -
Un fois le thyristor amorcé,
maintien d’un courant anode-cathode IAK supérieur à un
courant dit “d’accrochage” IL.
(dépendant du thyristor) |
Quand le courant anode-cathode IAK est inférieur au courant minimum de maintien pendant un temps supérieur au temps de désamorçage. |
Nous
venons de voir le fonctionnement avec des tensions continues mais le SCR offre
des comportements en alternatif très intéressants également car on peut le déclencher
ou on le désire sur un cycle. Il se désamorce naturellement à chaque
changement d'alternance puisque la tension passe par 0.
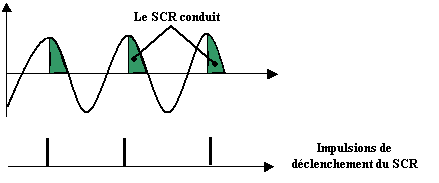
Comme on peut le voir sur le dessin ci-dessus, le SCR est déclenché à
un moment bien précis sur l'alternance (partie verte). On peut donc faire
varier la puissance moyenne d'un dispositif par le biais d'un SCR.
Pour pouvoir travailler sur les deux alternances du cycle, il est nécessaire
d’utiliser un pont redresseur de fort calibre pour une commande de puissance.
Utilisation
:
C'est essentiellement un composant d'électrotechnique
utilisé pour le redressement commandé. En électronique, on l’utilisera dans
les circuits de protection contre les surtensions de l’alimentation. En électronique
industrielle, on le retrouve dans les commandes des moteurs électriques, des
charges de haute puissance et de tous les dispositifs nécessitant d’être
commandés pour laisser transiter de la puissance.
Application
Protection
d’un circuit électronique : le principe consiste en une sécurité qui
permette de supprimer la tension de sortie si celle-ci excède une valeur qui
peut être destructive pour le matériel alimenté. Voici comment :
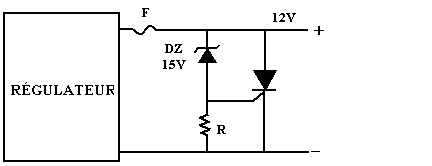
L’alimentation délivre une tension V de 12
volts. On disposons entre le plus et le moins une résistance et une diode zener
de la valeur de la tension maximum supportable par le matériel alimenté soit
15 volts dans le cas de notre exemple.
En fonctionnement normal, la diode zener est
utilisée sous son seuil et la gâchette du SCR n'est pas alimentée. Si,
pour une raison ou une autre, la tension de sortie de l'alimentation excède la
valeur fixée par la zener, celle ci entre en zone d'avalanche et conduit. On
retrouve à ses bornes la tension de zener, ce qui a pour effet d'alimenter la gâchette
du SCR. Celui-ci en conduisant, provoque un court-circuit entre (+) et (-) ce
qui fait fondre le fusible et protège le matériel alimenté.
Vérification
d'un SCR :
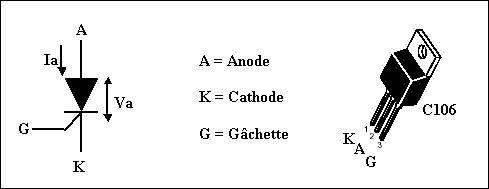
À l'aide
d'un multimètre, on peut vérifier un SCR en procédant comme suit :
1. Sélection
de l'échelle : choisir sur le multimètre l'échelle qui permet de vérifier
les jonctions à semi-conducteur (diode).
2. Test de
la jonction gâchette/cathode : placez la sonde rouge sur la gâchette et la
noire sur la cathode. Vous devriez obtenir l'équivalent d'une jonction en
conduction (0,6 Volt). Intervertissez les deux sondes et l'affichage indiquera
“infini ou OverLoad”.
3. Test de
non-conduction entre anode et cathode : placez la sonde rouge sur l'anode et
la noire sur la cathode sans toucher la gâchette. Le SCR ne doit pas conduire
(infini ou OverLoad). Intervertissez les deux sondes, le SCR ne doit toujours
pas conduire (infini ou OverLoad).
4. Test
d'amorçage du SCR par la gâchette : placez la sonde rouge sur l'anode et
la noire sur la cathode. Si vous ne touchez pas la gâchette, le SCR ne doit pas
conduire. Maintenant, placez un court-circuit entre l'anode et la gâchette pour
amorcer le SCR, il doit conduire (affichage = 0,57 Volt). Si vous enlevez le
court-circuit entre l'anode et la gâchette, le SCR doit continuer de conduire.
Autres
moyens d’amorçage
En élevant la tension entre anode et cathode jusqu’à ce que le phénomène d’avalanche se produise pour l’un ou l’autre des transistors, on déclenche la réaction en chaîne qui rend le SCR conducteur. On déconseille toutefois d’utiliser cette méthode car bien souvent, le fabricant ne garantit pas de manière précise la valeur de tension d’avalanche.
À chaque fois que la température s’élève de 14oC environ, le courant de fuite d’un transistor au silicium double. Il est plausible que l’intensité de ce courant devienne suffisante pour amorcer le thyristor. Ce procédé d’amorçage, plutôt incertain, n’est évidemment pas très recommandable.
Dans
une photodiode, une fenêtre transparente permet à la lumière d’atteindre la
jonction où elle vient moduler l’intensité du courant de fuite en inverse.
Un tel procédé peut être employé sans inconvénient pour amorcer un
thyristor. Une certaine catégorie de thyristors, spécialisés à cet effet,
peuvent être amorcés par la lumière, ce sont les LASCR ou “Light Actived
Silicon Controlled Rectifier”.
2.
Le TRIAC
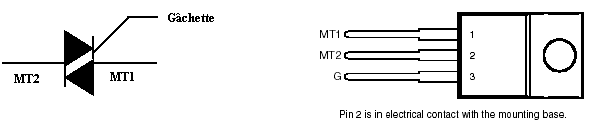
MT (1
et 2) est l'acronyme de Main Terminal
Le triac est la version bidirectionnelle du SCR,
élément unidirectionnel. Son nom est la contraction de “Triode
for Alternative Current”,
c’est-à-dire élément à trois électrodes à semi-conducteur, pour
l’alternatif.
Le triac présente, comme le SCR, soit une très
grande résistance, soit une très faible résistance lorsqu’il a été amorcé
et permet le passage du courant dans les deux sens.
Extérieurement, le triac a le même aspect
qu’un SCR, mais intérieurement, c’est un véritable circuit intégré,
puisqu’une seule pastille permet d’assurer la fonction de deux SCR.
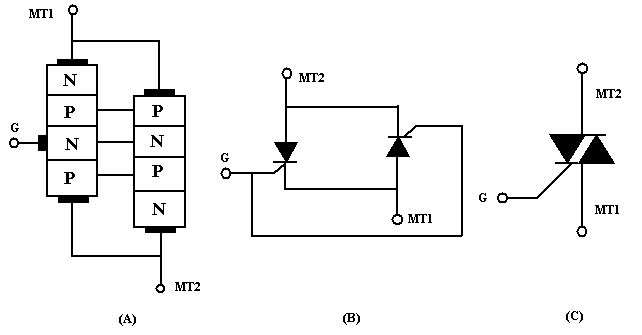
Le
triac devant conduire dans les deux polarités, on ne peut parler d’anode et
de cathode comme c’était le cas pour le SCR. Ses deux électrodes reçoivent
dorénavant les désignations MT1 et MT2. L’électrode de commande demeure
encore la gâchette.
Courbe
caractéristique
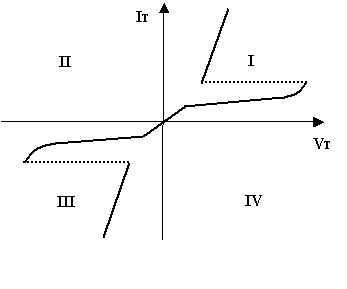
La caractéristique du triac, illustrée à la
figure #229 est obtenue par la réunion des caractéristiques directes de chaque
SCR. Si MT2 reçoit une tension positive par rapport à MT1, qu’on relie à la
masse, le triac fonctionne dans le premier
quadrant du graphique ; la tension VT et le courant IT
sont positifs.
Dans le cas inverse, où MT1 est porté à un
potentiel négatif par rapport à MT2 qui est relié à la masse, on travaille
dans le troisième quadrant ; la
tension VT
et le courant IT
sont maintenant négatifs.
Selon les polarités de la tensions aux bornes
du triac, l’impulsion de déclenchement à la gâchette amorcera le SCR
approprié, l’autre demeurant bloqué.
Comme pour le SCR, on peut atteindre la valeur
de déclenchement sans signal de gâchette en appliquant la tension de
retournement VBR. Celle-ci n’a pas
forcément la même valeur dans les deux sens. Par ailleurs, le dispositif peut
basculer à l’état passant quel que soit le sens de l’impulsion de gâchette
(positive ou négative) et ce indépendamment du sens de la tension entre MT1 et
MT2 (voir fig. #230). Cette caractéristique rend le triac fort versatile.
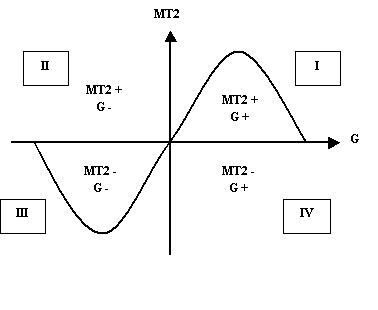
Les
besoins en tension et en courant de la gâchette sont quelque peu différents dépendamment
du mode d’opération utilisé. Si l’opération se situe dans le quadrant I,
c’est-à-dire que la gâchette reçoit une impulsion positive par rapport à
MT1, et que MT2 est positive par rapport à MT1 (mode d’opération comparable
à celui du SCR), la gâchette est à ce moment la plus sensible. Dans ce mode
la gâchette nécessite le minimum de courant
pour commuter correctement le triac en conduction. Les trois autres modes
nécessitent de plus fortes impulsions de commande en particulier dans le
quadrant IV. Il en résulte qu’il faudra parfois recourir à des circuits de déclenchement
spéciaux pour s’assurer une commande symétrique du triac.
Commande
de puissance par angle d’amorçage alternatif
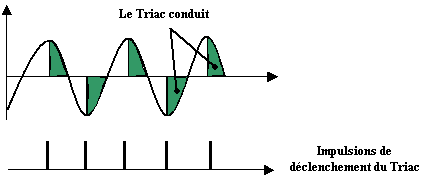
La
commande de puissance qui fait usage d’un SCR nécessite un pont redresseur de
fort calibre pour pouvoir travailler sur les deux alternances d’un cycle. Grâce
à sa caractéristique bidirectionnelle, le triac permet d’éliminer ce pont
redresseur. Par l’entremise de la gâchette unique, il règle la conduction
pour les demi-cycles positifs et négatifs comme le montre la figure #231.
Tout
ce que le circuit de commande doit avoir de plus par rapport au montage à
simple SCR est un dispositif qui génère des impulsions de déclenchement
durant les alternances négatives et positives.
3.
Le DIAC (DIode for Alternative Current)
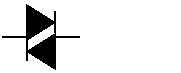
Comme
son symbole le laisse voir, il s'agit de deux diodes montées tête- bêche. Les
diodes ne sont pas de simples diodes, elles se comportent comme des diodes
zeners (relisez le chapitre consacré aux diodes). Le DIAC a été conçu spécifiquement
pour déclencher les “TRIACS” et les “SCR”. Voyons sa caractéristique.
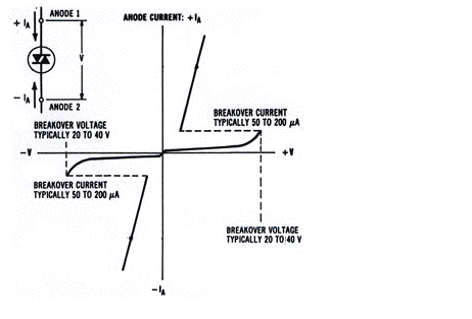
Le
diac est une diode symétrique dont la caractéristique présente une résistance
négative dans les deux sens de conduction. Pour déclencher la conduction, il
suffit d’excéder, dans un sens ou dans l’autre, la tension de retournement
située entre 20 et 40 volts. De faible puissance, le diac est généralement
employé comme amorce pour déclencher un dispositif plus puissant comme le
triac.
Amorçage
d’un thyristor par un autre thyristor
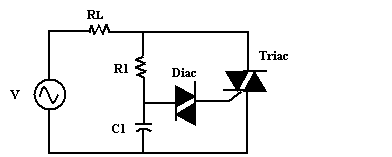
Fonctionnement
:
La figure # 234 illustre le principe d’un circuit qui emploie un thyristor pour amorcer un autre thyristor. Ce montage est bilatéral car il amorce durant les alternances positives et négatives de la tension d’alimentation. Durant l’alternance positive, C1 se fait charger via R1. Le triac, alors bloqué, ne provoque aucun courant dans la charge RL.
Celle-ci ne
fait que passer le faible courant de charge nécessaire au réseau RC, courant
beaucoup trop minime pour être en mesure de la mettre en fonctionnement.
Lorsque la charge de C1 atteint et dépasse légèrement la tension de
retournement du diac, celui-ci passe de l’état ouvert à l’état
conducteur. La charge de C1 se trouve alors appliquée à la gâchette du triac,
lequel devient à son tour conducteur. Le même processus se déroule en sens
inverse durant une alternance négative.
Le réseau RC a
pour effet de retarder la montée de tension sur le diac ce qui permet, en
jouant sur la valeur de R1, de varier l’angle de conduction du triac.