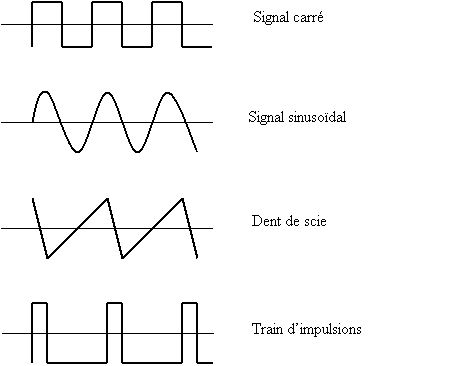
13: Les
oscillateurs
Partout où vous regarder dans le domaine de l'électronique, vous
trouverez des oscillateurs. Il y en a dans votre montre, votre téléviseur, vos
radios, votre voiture, votre ordinateur. Ils font tous appel au même principe
et bien que conçus pour des applications très différentes, répondent aux mêmes
critères.
À partir de
seulement une alimentation DC à l’entrée du circuit, on obtient une onde
alternative répétitive à la sortie. Un oscillateur est donc un circuit qui
convertit l’énergie électrique DC en énergie électrique CA.
Classification
Il existe une grande variété d'oscillateurs comme le montre le tableau
ci-dessous.
|
Sinusoïdaux |
Fixes :
RC, LC et quartz Variables : LC, VCO (diodes varicaps) |
|
Non sinusoïdaux |
à relaxation : multivibrateurs trapézoïdaux, rampes, dents de
scie |
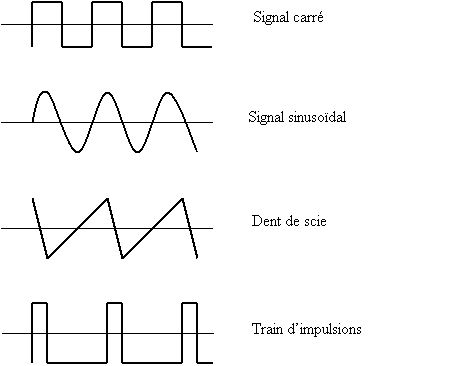
La
réaction positive ou rétroaction
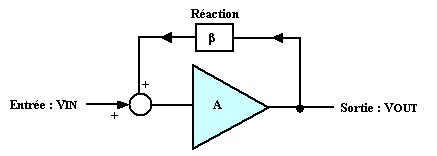
Un oscillateur est composé
d'un amplificateur duquel on prélève une partie du signal de sortie que l'on réinjecte
vers l'entrée.
Nous avons déjà fait cela mais dans le but de stabiliser
l'amplificateur, d'augmenter sa bande passante et surtout de ne pas le
transformer en oscillateur.
Dans
le cas de l’oscillateur, le signal prélevé de la sortie sera réinjecté
en phase. C’est
ce qu’on appelle la réaction positive.
La réaction positive consiste à prélever une fraction du signal amplifié et de la retourner dans le circuit d’entrée avec un déphasage de 0 degré.
Le report d’énergie est effectué par un circuit RC, LC ou un cristal (quartz). Si le sens des connections est convenable, le courant de base tend à renforcer le courant de collecteur qui lui a donné naissance et le système tombe en régime d’auto entretien. Ce phénomène est appelé oscillation.
Si
nous appelons A le gain et l'amplificateur et b
le gain du système de réaction, le critère de BARKHAUSEN définit
la condition pour que le système entre en oscillation.
Considérons
séparément chacun des deux éléments constitutifs d’un oscillateur
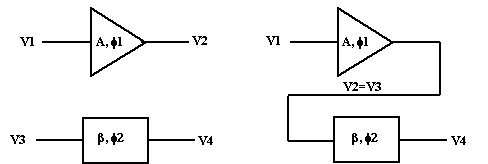
Nous
supposerons que l’amplificateur fonctionne en régime linéaire : à tout
signal sinusoïdal appliqué à son entrée, correspond un autre signal, lui
aussi sinusoïdal, recueilli sur sa sortie. Si V1 et V2 sont les amplitudes
respectives de ces tensions, on appelle gain de l’amplificateur, le rapport :
V2
A = ----------
V1
Généralement,
l’amplificateur introduit non seulement un gain, mais aussi un déphasage
entre les deux sinusoïdes, que nous noterons f1.
Ces
mêmes notions s’appliquent au réseau de rétroaction, bien que ce réseau
soit passif. Quelle soit la structure de ce réseau, on peut définir son gain,
rapport des amplitudes V4 et V3.
V4
b
= ----------
V3
Généralement,
le réseau de rétroaction atténue le signal qu’on lui applique, de sorte que
b est inférieur à l’unité. Pour sa part, ce réseau
introduit un déphasage que nous noterons f2.
Relions
maintenant les deux éléments en série (voir figure ci-dessus). La sortie de
l’amplificateur attaquant l’entrée du réseau passif, nous aurons à la
fois
V4
= A x b x V1
f
= f1
+ f2
(A
x b) est appelé gain en boucle ouverte
f
est le déphasage total
Si
V4 est supérieur à V1 et que le déphasage total est soit nul soit égal à un
multiple de 360o, on obtient l’auto entretien des oscillations en
refermons le montage sur lui-même.
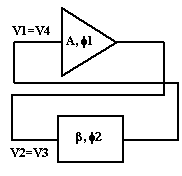
A
x b
≥ 1
f1
+ f2
= 0o ± 360o x K
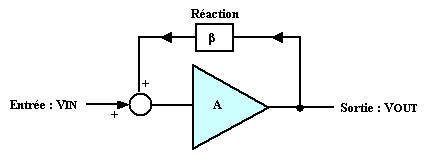
En
boucle fermé, le produit b
x VOUT
s’additionne à VIN,
de sorte que :
VOUT = A
VIN
+ A b
VOUT è
VOUT –
A b VOUT
= A VIN è
VOUT (1
– A b) = A x
VIN
D’où
:
VOUT
A
------ =
-----------------
VIN
1
– A b
Pour
différentier ce gain du gain en boucle ouverte, on le notera AC
(c est mis pour close).
VOUT
A
ACL
= ------ = -----------------
VIN 1 – A b
Une
fois amorcée, l'oscillation se maintient pour A x b
= 1
Si
A x b
<1 l'oscillation cesse.
Si
A x b
> 1, l’amplitude des oscillations augmente jusqu’à la saturation de
l’amplificateur. Le signal de sortie ressemblera plus à un signal carré
qu’à une sinusoïde.
Dans
le cas d’un amplificateur émetteur commun, c’est la contre réaction
introduite par la résistance d’émetteur RE
qui joue le rôle de limiteur de sorte que l’amplificateur ne sature jamais.
Le
réseau de rétroaction ou de réaction positive devra prendre en compte le
montage utilisé, déphaser ou pas le signal et appliquer le taux qui convient
à l'entrée.
Comment réinjecter
la sortie vers l'entrée ?
Il existe plusieurs méthodes, celles-ci sont d'ailleurs
constitutives et descriptives du montage. Tel que les classiques : Colpitts,
Pierce, Hartley (du nom des inventeurs), voyons quels sont les procédés de
couplages les plus fréquemment utilisés.
En fonction du type de montage
utilisé, (souvenez-vous, il y a trois montages fondamentaux pour le transistor)
nous appliquerons ou pas un déphasage au signal prélevé.
Émetteur
commun : déphase de 180°
Collecteur
commun : ne déphasage
pas
Base
commune : ne déphasage pas
Le réseau
RC ou oscillateur à déphasage :
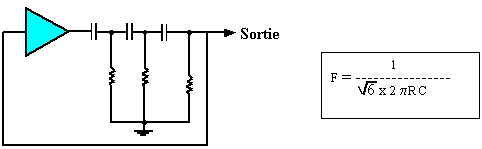
Voir le schéma ci-dessus, plusieurs commentaires d'abord :
-
l'amplificateur est un amplificateur émetteur commun, c-à-d que le
signal de sortie est déphasé de 180° par rapport à l'entrée.
-
Cet amplificateur est
polarisé en classe A de manière à offrir un signal le plus pur possible. Nous
verrons dans cette section que ce n'est pas une exigence systématique.
-
Le réseau de déphasage et
d'injection comporte 3 cellules RC identiques, d'une part pour déphaser le
signal de 180° (60° par cellule) et d'autre part pour atténuer le signal à
injecter vers l'entrée car nous n'avons pas besoin d'injecter un signal énorme
si nous tenons à conserver en sortie un signal sans distorsion. Ce type
d'oscillateur est sélectif, la fréquence d'oscillation est dictée par les
valeurs du réseau RC.
Comment s'amorce l'oscillation ?
C'est en général le problème
de tout oscillateur, le démarrage. L’oscillateur démarre-t-il tout seul dès
la mise sous tension ? Oui. En effet, pour que les oscillations prennent
naissance dans le circuit, il faut que son état de repos soit perturbé. Or, le
simple fait de fermer l’interrupteur qui alimente l’oscillateur provoque une
“secousse” électrique capable de déclencher l’état oscillatoire. Il y a
aussi les dérives thermiques, les tensions de bruit, qui pourraient jouer le même
rôle. En effet à la mise sous tension, le courant circule dans les composants
de l'amplificateur, du bruit (électrique) est généré, il est amplifié, le
bruit a pour caractéristique d'être large bande. La composante qui a la bonne
phase est ramenée vers l'entrée et le processus s'enclenche.
Le réseau
LC :
Identique
dans le principe (rétroaction du signal de sortie vers l'entrée), il est
composé d'une self et d'un condensateur. L'un ou les deux éléments peuvent être
variables, dans ce cas on pourra faire évoluer la fréquence d'oscillation.
La
fréquence d'oscillation sera déterminée majoritairement par la valeur de L et
de C et accessoirement par les capacités parasites du montages (elle existent
toujours).
On évaluera approximativement la fréquence d'oscillation par la classique formule de Thomson tirée du non moins célèbre :
LCw2
= 1
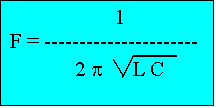
Voyons l'allure d'un oscillateur à réseau LC :
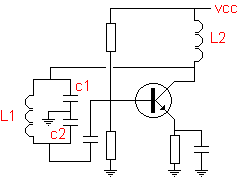
Voyons
ce qui s'y produit. Imaginons que l'oscillateur oscille. Nous retrouvons nos
oscillations sur le collecteur, vous remarquerez qu'on a placé une self L2 en série.
Cette inductance qui présente un réactance élevée empêche l'énergie HF de
se propager dans l'alimentation ce qui serait dommageable. Le collecteur charge
un circuit accordé composé de L1 en // C1 C2. Une partie de la tension
alternative se développe aux bornes de C2 et est envoyée à la base du
transistor. Le système est bouclé, l'oscillation se produit.
Si
nous rendons un des éléments du circuit oscillant variable, self ou capacité,
notre oscillateur pourra osciller sur plusieurs fréquences.
Les différents types d'oscillateurs LC :
Nous allons voir dans cette section les quelques grands types
d'oscillateurs et leurs particularités. En fait il n'y a pas de grandes différences,
les principes généraux sont les mêmes pour tous.
1.
L'oscillateur Colpitts émetteur
commun
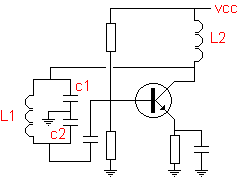
C'est
celui que nous venons de voir. Si nous réduisons le schéma à son équivalent
en alternatif ceci nous donne ce schéma qui est plus facile à comprendre.
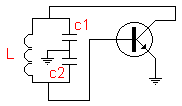
Nous retrouvons ce que nous avions déjà vu en introduction à
l'oscillateur. Le collecteur charge un circuit accordé parallèle, un fraction
de la tension que l'on récupère
aux bornes de C2 est injectée dans la base ce qui maintient l'oscillation. Pour
l'approximation de la fréquence d'oscillation, il faut prendre en compte comme
capacité la résultante de C1//C2, car il faut également tenir compte et des
capacités parasites du montage et des capacités propres du transistor. Le
Colpitts a été l'un des premiers montage utilisé par les radioamateurs et a
donné naissance à quelques variantes toujours sur le même thème.
2. L'oscillateur Colpitts base commune
Vous retrouverez souvent le
montage Colpitts en montage oscillateur base commune, son principal avantage est
d'annuler l'effet de la capacité collecteur base du transistor. La tension de réinjection
est envoyée sur l'émetteur ce qui provoque bien des variations de polarisation
de la jonction base-émetteur et conséquemment une variation de courant Ic.
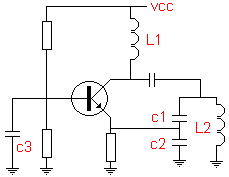
Le montage base commune (la base est à la masse du point
de vue alternatif par le biais du condensateur C3) permet à l'oscillateur de
fonctionner sur des fréquences plus élevées que son homologue émetteur
commun. Dans ce montage la tension de réaction est reprise aux bornes du
condensateur C2. On reconnaît un oscillateur Colpitts à son pont
diviseur capacitif.
3.
L'oscillateur Clapp
Le
Clapp est un dérivé et une amélioration du Colpitts. Dans le Colpitts les
capacités parasites du montage (et elles sont nombreuses, pensez à tous ces
fils parcourus par du courant et séparés par un diélectrique) et les capacités
intrinsèques du transistor influent fortement sur la fréquence d'oscillation.
Dans le Clapp, il a été rajouté une capacité en série dans le circuit
d'accord et c'est cette capacité qui est déterminante avec la self pour déterminer
la fréquence d'oscillation.
Schéma :
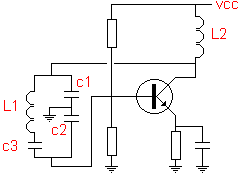
Par rapport au Colpitts, on note la présence d'une capacité C3 en série avec la bobine L1. Pour déterminer ou évaluer la fréquence d'oscillation, on appliquera la classique formule de Thomson en utilisant la valeur de C3 pour C dans la formule. Le Clapp est plus stable que le Colpitts
On
reconnaît un oscillateur Clapp car il s'agit d'un Colpitts avec un condensateur
en série dans le circuit d'accord.
4.
L'oscillateur Hartley
Dans cet
oscillateur, nous trouvons deux inductances en série en lieu et place du pont
diviseur capacitif. Les deux selfs représentées sur le schéma n'ont sont en
fait qu'une seule sur laquelle on réalise une prise. Le Hartley a été l'un
des premiers oscillateurs utilisé en radio.
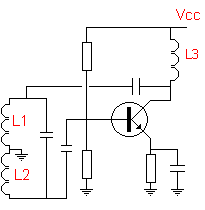
Vous êtes habitué maintenant au principe qui vous est devenu familier. Le collecteur charge un circuit accordé c-à-d résonnant sur une fréquence f dictée par la valeur de L1+L2 et C. La tension qui de développe aux bornes de L2 est envoyée à la base du transistor ce qui maintient l'oscillation. Comme déjà dit les éléments L1 et L2 ne sont qu'une seule self sur laquelle on vient faire une prise médiane. Il est ainsi possible de régler le taux de réinjection en s'éloignant plus ou moins de la masse.
On reconnaît l'oscillateur Hartley grâce aux deux
inductances (ou à la prise intermédiaire) du circuit résonnant.
Multivibrateur astable à ampli Op UA741
Un multivibrateur astable est une horloge qui
rythme le fonctionnement des circuits numériques. Son principe est basé sur la
charge et la décharge du condensateur C.
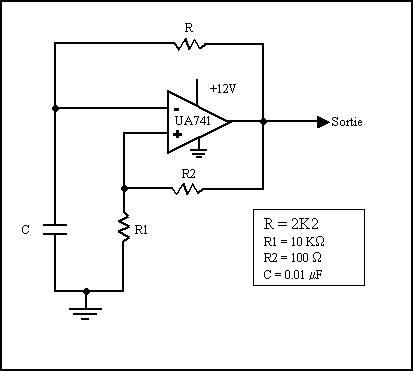
Multivibrateur astable à minuterie NE555
Le 555 est un circuit électronique miniaturisé qui est utilisé comme temporisateur. Il est basé sur la stabilité des circuits “RC” pour lesquels on peut prévoir le temps dont ils ont besoin pour atteindre une tension donnée. Les étapes qui suivent vont vous faire découvrir les fonctions des broches de ce circuit intégré très courant.
L'alimentation
positive est assurée par la broche 8 ; la tension négative de la source doit
être branchée à la broche 1. Les broches sont numérotées selon le schéma
ci-dessous ; il y a au moins un marqueur dessiné sur le circuit intégré, soit
un point creusé dans le plastique dans un coin du C.I., soit une encoche au
centre du C.I. ; la broche 1 se trouve alors immédiatement à gauche de cette
encoche ou de ce point selon le cas. Les autres broches sont numérotées dans
le sens anti-horaire.
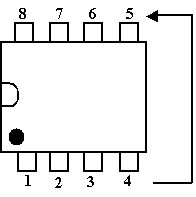
a.
Schéma fonctionnel du 555
La figure #3 représente un schéma fonctionnel d'une minuterie 555, une
minuterie intégrée à 8 broches. Le comparateur du haut a une entrée de seuil
(broche 6) et une entrée de commande (broche 5). Si l'entrée de commande n'est
pas utilisée alors la tension de commande est égale à 2 x (VCC / 3) et lorsque la tension de seuil dépasse
la tension de commande, la sortie du comparateur du haut met la bascule au
niveau haut.
Le comparateur du bas a son entrée inverseuse, appelée entrée de basculement, reliée à la broche 2. L'entrée non inverseuse a une tension fixe de VCC / 3. Lorsque la tension d'entrée de basculement est légèrement inférieure à VCC / 3, la sortie de l'amplificateur opérationnel passe au niveau haut et remet la bascule au niveau bas.
Le collecteur du transistor à décharge est relié à la broche 7. Lorsque cette broche est raccordée à un condensateur externe de minutage, la sortie Q de niveau de la bascule sature le transistor et décharge le condensateur. Lorsque Q est au niveau bas, le transistor s'ouvre et le condensateur se charge. Le signal complémentaire de la bascule passe à la broche 3.
Et enfin si la
sortie externe de remise à niveau bas (broche 4) est mise à la masse, le
dispositif est inhibé (ne peut fonctionner).
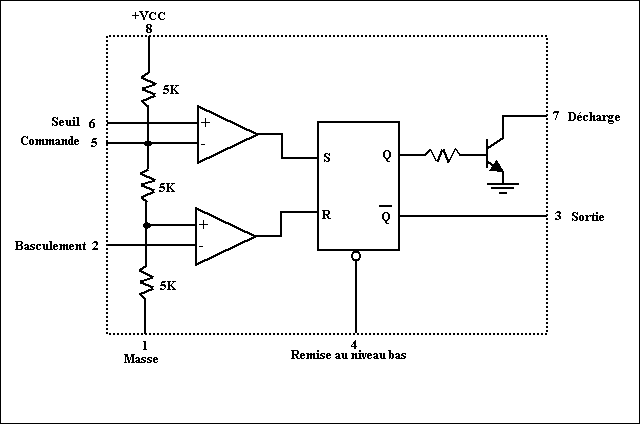
b.
Fonctionnement en Oscillateur
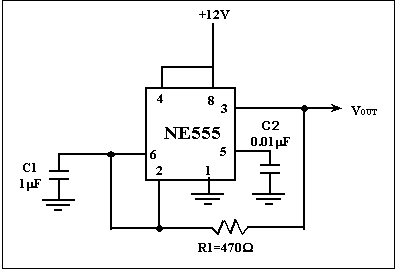
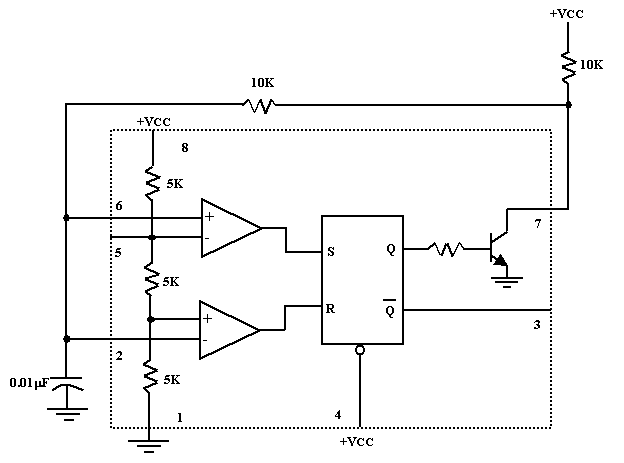
Les VCO : Voltage Controlled Oscillators ou oscillateurs commandés en
tension :
Nous avons vu que l'on
pouvait faire varier la fréquence d'un oscillateur en ayant un des éléments
du circuit résonnant qui soit variable, que ce soit la self par le biais d'un
noyau plongeur soit par la capacité qui peut être un condensateur variable. On
peut fabriquer un oscillateur variable qui sera commandé par une tension, c-à-d
que la fréquence de sortie sera dépendante de la tension continue appliquée.
Ceci sera réalisé en remplaçant le condensateur variable (le CV) par un
dispositif à diodes Varicaps. Ces diodes ont la propriété de changer de
capacité en fonction de la tension continue qu'on leur applique. L'intérêt
d'un tel montage est de remplacer le CV mécanique, rare et cher par un
dispositif électronique peu coûteux, de plus le VCO est indispensable dès
lors que l'on veut réaliser un système fonctionnant en boucle comme un PLL.
(voir plus loin)
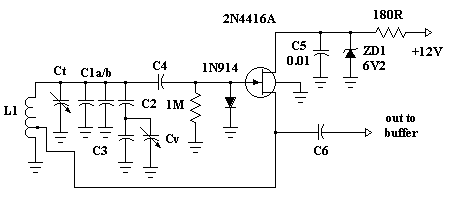
Voici un schéma tiré de l'excellent site de VK2TIP on y reconnaît un
classique oscillateur Hartley (la self et les prises). La fréquence
d'oscillation est commandée par un condensateur variable Cv. Modifions ce
circuit de manière à lui adapter des diodes varicap
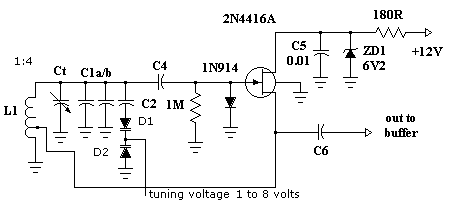
et voilà, le CV a été remplacé par deux diodes varicap. Il
suffit d'injecter la tension de commande comme suit :
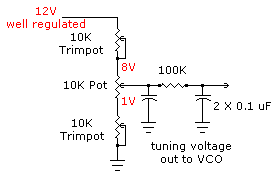
Vous trouvez à gauche le schéma
de la commande en tension continue de ce montage. Les résistances variables qui
entourent le potentiomètre servent à fixer les butées hautes et basses de
tension qui fixeront les valeurs limites hautes et basses d'oscillation du VCO.
Notez que le montage est sérieusement découplé par des condensateurs de manière
à obtenir une tension de commande aussi propre que possible.
Remarques sur la construction des oscillateurs :
Bien que la technique évolue plus que rapidement, le constructeur amateur et radioamateur a souvent l'occasion de procéder à l'expérimentation d'oscillateurs variables pour la réalisation de VFO (Variable Frequency Oscillateur). Pour obtenir de bons résultats, il faut respecter quelques règles simples :
Caractérisation des oscillateurs :
Les oscillateurs variables comme les fixes d'ailleurs
ont des caractéristiques, voici brièvement ce qu'il faut avoir vu au moins une
fois.
Fréquence
ou bande de fréquence
Si l'oscillateur est variable, cette variation pourra s'exprimer en % de la fréquence centrale. Ex un oscillateur conçu pour être un VFO couvre de 5 à 5,5 MHz soit 10%.
Niveau du signal de
sortie
C'est une puissance qui pourra être exprimée en mW ou dBm sur 50 W
Distorsion
d'amplitude
Quand l'amplitude du signal de sortie n'est pas constante sur un cycle, ce phénomène s'appelle distorsion d'amplitude.
Distorsion de phase ou bruit de phase, ou pureté spectrale
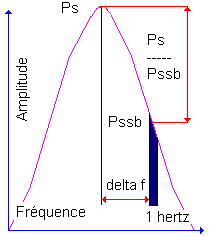
Peut-être le plus grave défaut qu'un oscillateur
puisse présenter. Il apparaît une variation de la phase du signal sur un cycle
ce qui génère du bruit. A votre gauche vous pouvez observer l'allure du
spectre d'un oscillateur. L'amplitude s'exprime par rapport à la fréquence et
non par rapport au temps comme sur un oscilloscope. On quantifie le bruit de
phase en mesurant dans une bande passante de 1 Hz la puissance de l'oscillateur
à un écart de x kHz par rapport à la fréquence centrale. La puissance à la
fréquence centrale vaut Ps et à x kHz Pssb. Le rapport détermine le bruit de
phase et s'exprime en dBC/Hz soit en dB par rapport à la porteuse par hertz à
un écart de x kHz
C'est la capacité qu'à un
oscillateur à osciller sur une même fréquence. Ceci s'exprime en ppm (part
par million) en fonction du temps.
Les PLL (Phase lock Loop) ou oscillateurs à verrouillage de phase :
Ce chapitre eut été
incomplet si nous n'avions évoqué les PLL. Ils remplacent très tranquillement
souvent en moins bien les classiques oscillateurs que nous venons de voir
ci-dessus. Vous en trouvez naturellement dans vos émetteurs-récepteurs, dans
vos ordinateurs (avant c'était un quartz qui oscillait mais vu les fréquences
atteintes maintenant, cette mission est dévolue à un synthétiseur). Voyons
comment cela fonctionne.
Le
but à atteindre :
Fournir une tension sinusoïdale,
sur une plage de fréquence f1 à fn stable en amplitude et en phase.
Les
limitations des oscillateurs classiques :
Les oscillateurs LC
classiques ont une limitation de taille, la stabilité en fonction de la fréquence
de travail. La SSB et la CW demandent une excellente stabilité des oscillateurs
sous peine de transformer la voix écoutée en canard très rapidement. Au delà
d'une quinzaine de MHz la tâche devient difficile.
Une
idée de solution :
Comparer et réajuster la fréquence d'oscillation d'un oscillateur libre par rapport à une référence ultra stable.
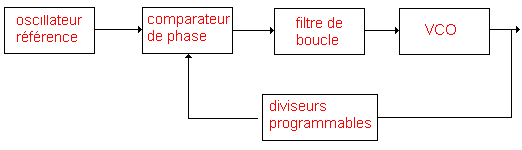
Voici ci-dessus le synoptique
d'un système à verrouillage de phase autrement appelé synthétiseur. Le
principe n'est pas récent mais il a fallu attendre le développement de
composants idoines pour passer à l'étape industrielle.
Comment
cela marche t'il ?
Nous
trouvons dans le 1er bloc à gauche l'oscillateur de référence.
C'est un
vulgaire oscillateur à quartz (étude au prochain chapitre). Sa particularité
est d'être très stable car la fréquence d'oscillation est contrôlée par un
cristal de quartz. La stabilité est de 2 à 5 ppm dans la gamme des températures
usuelles. La fréquence d'oscillation, en fonction du montage, est basse, entre
5 et 10 MHz
Deuxième
bloc fonctionnel le comparateur de phase.
Cet ensemble
comporte deux entrées et une sortie. Sur les entrées, on applique les signaux
à comparer, la sortie nous fournit une indication sous forme de créneaux et
pics de tension de l'écart entre les deux fréquences d'entrée.
Comme son nom l'indique, il
s'agit d'un filtre composé de résistances et capacités qui a la lourde tâche
de convertir les impulsions issues du comparateur de phase en une tension
continue
C'est un oscillateur commandé
en tension, la fréquence de sortie évolue en fonction de la tension appliquée
au(x) varicap(s). Il couvre l'intégralité de la gamme à écouter ou sur
laquelle transmettre, sa stabilité intrinsèque doit être bonne.
Une entrée, une sortie. A l'entrée on applique un signal qui ressortira divisé en sortie en fonction du nombre diviseur que l'on demandera. On aura donc en sortie
Fs = Fe/ n
Fs = fréquence de sortie, Fe celle d'entrée et n, rang du diviseur.
Les synthétiseurs ont un gros défaut : ils sont
terriblement bruyants et n'égalent pas en pureté spectrale les oscillateurs
classiques ou à quartz. Un oscillateur bruyant, utilisé comme oscillateur
local d'un récepteur, vous fournira une réception dégradée en présence de
puissants signaux adjacents.
Nous allons nous arrêter ici pour l'étude des
oscillateurs "libres", nous étudierons au prochain chapitre les
oscillateurs à quartz.