
LA TÉLÉVISION-Suite-
8. Déflexion, synchronisation et haute tension :
8.1. Production de balayage :
La partie "réception" que nous avons analysé jusqu'à présent est, en ce qui concerne son schéma bloc, analogue à celle d'un récepteur de radiodiffusion. Celle que nous allons étudier maintenant n'existe évidemment pas dans une radio.
En télévision il est nécessaire de synchroniser les balayages à la réception avec ceux de l'émission. À cette fin, on transmet des signaux de synchronisation à chaque fin de ligne et à chaque fin de trame. Pour faire dévier le faisceau électronique tant lors de l'analyse de l'image que lors de la synthèse, il faut fournir aux organes de déflexion des courants croissants linéairement pendant la durée d'une ligne ou d'une trame et reprenant très rapidement leur valeur initiale à la fin d'un cycle.
La forme de ces signaux est dite en "dents de scie"
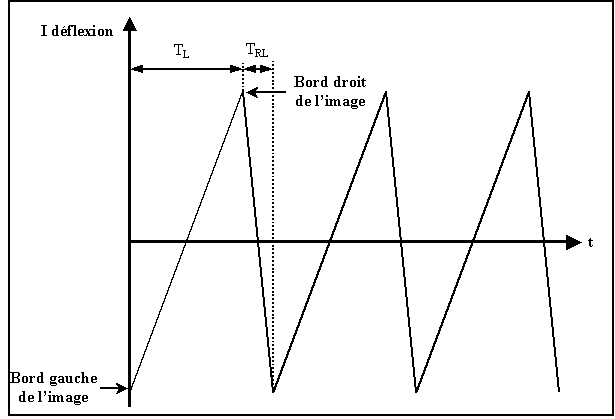
TL + TRL = 1/ 15750 = 63.5 µs
TRL = 16 % de 63.5 µs = 10.2 µs
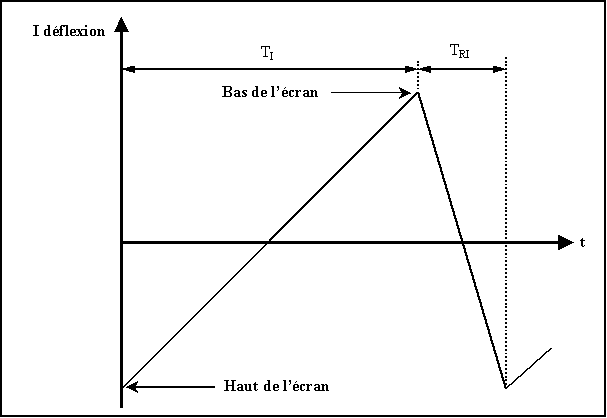
TI + TRI = 1/ 60 = 16.67 ms
TRI = 8 % de 16.67 ms = 1333 µs
8.1.1. Formes des tensions provoquant un courant en dents de scie dans les circuits :
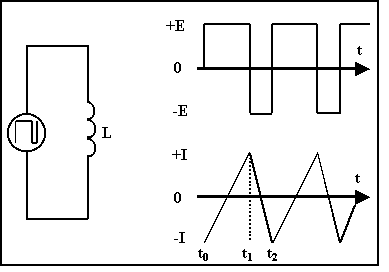
La tension qui alimente la bobine est une onde alternative rectangulaire de forme asymétrique. En t0, la polarité de la tension source vient de s’inverser ; le courant est maximal et négatif. À cause de l’inductance, l’intensité du courant diminue linéairement, passe par zéro, puis croît dans le sens positif. En t1, le générateur inverse ses polarités et applique une forte tension négative à l’inductance. Le courant se met alors à diminuer, passe par zéro puis croît dans le sens négatif. Entre t1 et t2, la pente est plus forte qu’entre t0 et t1 car la tension négative est plus forte que la tension positive. Le courant qui traverse l’inductance a donc la forme d’une dent de scie ; c’est précisément ce genre de courant qui doit alimenter les bobines verticale et horizontale du déflecteur d’un téléviseur.
8.1.2. Cas d’un circuit comprenant R et L :
Les bobines de déflexion d’un téléviseur ne sont pas des inductances pures ; les enroulements qui les composent offrent de la résistance. Une bobine de déflexion équivaut donc à un circuit série formé d’une inductance et d’une résistance.
Comme le montre la figure suivante, il faut appliquer une onde en forme de dents de scie à la résistance (A) et une onde de forme rectangulaire à l’inductance pure (B) pour obtenir un courant en forme de dents de scie. La somme des deux formes de tension est une onde trapézoïdale (C) ; c’est le type d’onde qu’il faut appliquer aux bobines du déflecteur pour y obtenir des courants en forme de dents de scie.
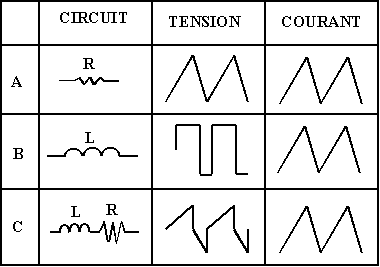
Les valeurs relatives des tensions de la dent de scie et de l’onde rectangulaire dépendent des valeurs relatives de la réactance inductive et de la résistance ohmique du bobinage. Les bobines de déflexion horizontale et verticale étant différentes, de même que les fréquences auxquelles elles sont soumises, les formes et les amplitudes des tensions qu’on obtient à leurs bornes sont différentes.
8.1.3. La production de balayage comprend trois grandes parties :
8.2. Séparation et triage :
Le signal vidéo complet contient trois informations (signal vidéo ou image, impulsions de noircissement et impulsions de synchronisation), une nous suffit maintenant : celle qui est destinée au déclenchement des bases de temps "trame" et "ligne".
La première opération est effectuée par un étage appelé "séparateur" qui élimine du signal vidéo complet tout ce qui concerne l'image mais conserve les signaux de synchronisation. Il agit à la façon d'un rabot qui couperait tout ce qui dépasse le niveau des signaux de synchronisation.
La deuxième opération consistera à trier les signaux en fonction de leur destination : balayage vertical ou balayage horizontal.
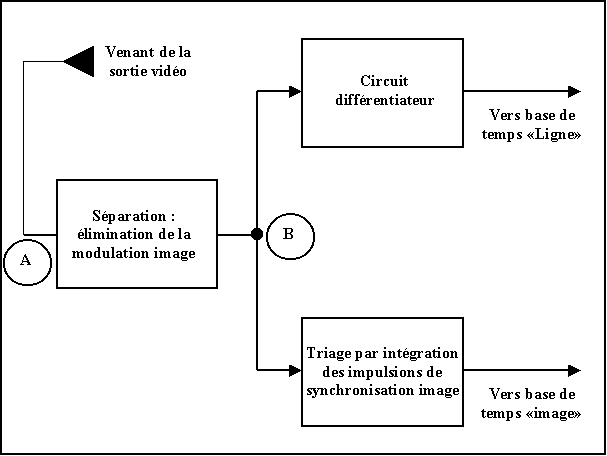
8.2.1. Séparation :
L'élimination des signaux de modulation image est fondée sur la différence d'amplitude qui existe entre les impulsions de synchronisation et les signaux de modulation.
Le fonctionnement de l'étage séparateur repose sur le blocage et la saturation d'un transistor.
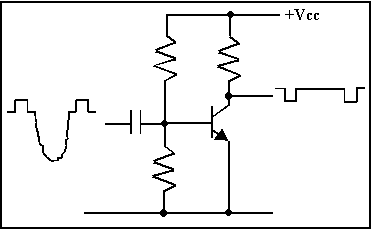
Le signal vidéo est appliqué via un condensateur sur la base d'un transistor NPN. La modulation vidéo négative bloque le transistor; seules les impulsions positives de synchronisation provoquent l'apparition du courant d'émetteur. On obtient aux bornes de la résistance de charge des signaux de phase inverse correspondants uniquement à la synchronisation.
Si on considère le schéma bloc précédent, la forme d'onde au point (A) est :
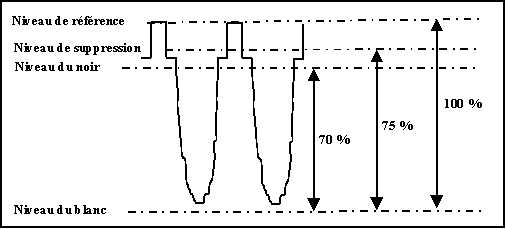
La forme d'onde au point (B) est :
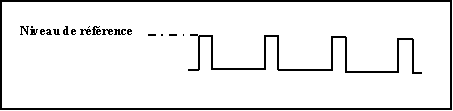
8.2.2. Triage des impulsions :
8.2.2.1. Principe:
Pour trier les impulsions de synchronisation, on transforme par intégration (filtre passe bas) la différence de durée des impulsions verticale et horizontale en une différence d'amplitude.
8.2.2.2. Circuit intégrateur ou filtre passe bas
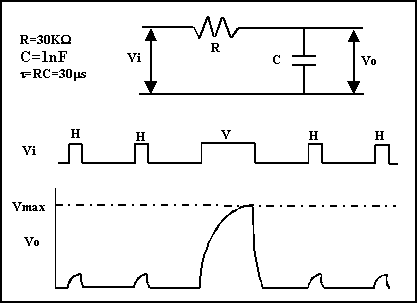
Effet des impulsions horizontales sur l’intégrateur : voyons comment se comporte le circuit intégrateur lorsque des impulsions de synchronisation horizontale se présentent à son entrée.
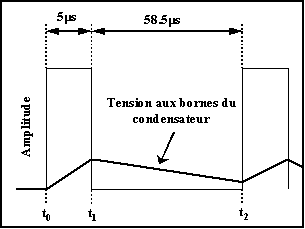
En t0, la tension est appliquée au circuit et le condensateur commence à se charger à travers la résistance. Cette charge dure 5 µs, soit le temps de l’impulsion horizontale entre t0 et t1.
La constante de temps du circuit est t = RC = 30 KW x 1 nF = 30 µs ===> 5t = 150 µs
Durant la première constante de temps, le condensateur se charge à 63.2 % de sa valeur finale. Il se charge pendant 5 µs soit 15.35 % (V = E(1-e-(t/RC)) avec E=tension finale.
Le condensateur accumule donc seulement 15.35 % du voltage total de l’impulsion appliquée à l’entrée de l’intégrateur. Entre t1 et t2, il s’écoule 58.5 µs (63.5 µs - 5 µs) et le condensateur perd une bonne partie des charges qu’il avait accumulées entre t0 et t1.Ainsi, sous l’effet des impulsions de synchronisation horizontale, la tension aux bornes du condensateur ne devient jamais assez élevée pour influencer le fonctionnement de l’oscillateur vertical. À noter que les impulsions d’égalisation (durée = 2.54 µs, 2 par ligne soit 6 impulsions au total) produisent sur l’intégrateur, un effet identique à celui des impulsions de synchronisation horizontale (voir figure suivante).
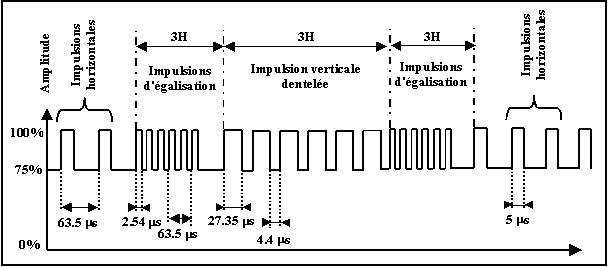
Effet des impulsions verticales sur l’intégrateur : voyons maintenant ce qui se passe lorsqu’une impulsion verticale dentelée apparaît à l’entrée de l’intégrateur. Disons d’abord que l’impulsion est dentelée afin de maintenir l’oscillateur horizontal en synchronisme avec celui de l’émetteur pendant le retour vertical.
Au temps t0, la tension est appliquée à l’entrée de l’intégrateur et le condensateur commence à se charger à travers la résistance. Cette charge dure pendant 27.35 µs. La constante de temps du réseau RC est 30 µs et durant la première constante de temps, le condensateur se charge à 63.2 % de sa valeur finale.
Le condensateur se charge pendant 27.35 µs, soit 59.8 % (V=E(1-e-(27.35/30)). Le condensateur accumule donc 59.8 % du voltage total de l’impulsion d’entrée.
Entre t1 et t2, il s’écoule seulement 4.4 µs et le condensateur perd moins de 13.6 % des charges qu’il avait accumulées entre t0 et t1. En t2, une nouvelle impulsion provoque la charge du condensateur ; sa tension s’accroît jusqu’en t3 où, à nouveau, il se décharge pendant 4.4 µs.
La tension du condensateur augmente progressivement car le temps de charge est beaucoup plus long que le temps de décharge. Cette tension aux bornes du condensateur est appliquée à l’entrée de l’oscillateur vertical ; lorsqu’elle atteint une certaine valeur, cette tension force l’oscillateur à terminer son cycle d’oscillation et à amorcer un autre.
Dès la fin de l’impulsion verticale dentelée, le condensateur intégrateur se décharge car les impulsions d’égalisation et de synchronisation horizontale sont de courte durée.
8.2.2.3. Circuit différentiateur ou filtre passe haut
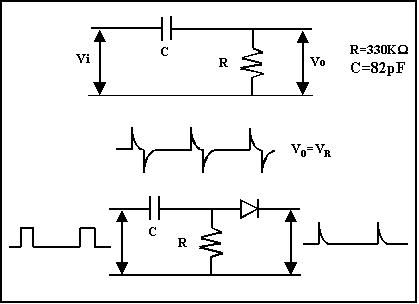
Les impulsions différentiées sont rabotées, on ne garde que les lancées positives ou négatives selon le cas.
8.3. Le balayage vertical :
Cette partie du téléviseur est appelée de diverses façons : balayage trame ou image, base de temps verticale, trame ou image.
8.3.1. Schéma bloc de la base de temps verticale
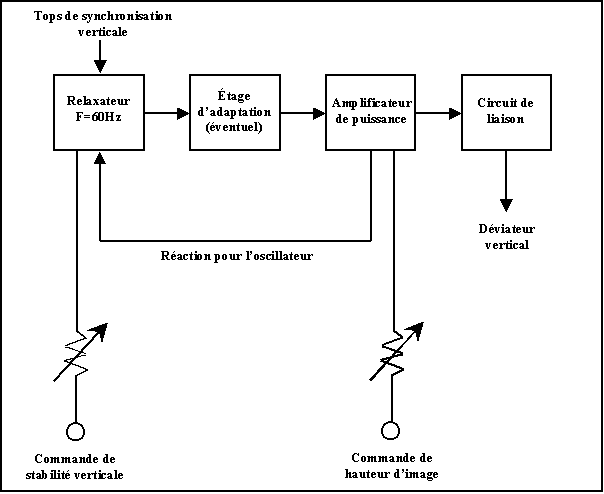
8.3.2. Fonctionnement :
La base de temps verticale commence au relaxateur ou oscillateur vertical. Cet oscillateur génère une sortie qu'il soit synchronisé ou non. La synchronisation verrouille l'oscillateur pour stabiliser la fréquence à 60 Hz.
Le fonctionnement de l'oscillateur est basé sur la charge et la décharge d'un condensateur à courant constant afin de produire la tension en dents de scie nécessaire aux bobines de déviation verticales.
La charge lente du condensateur dans une branche donne la montée linéaire et la décharge rapide dans une autre branche donne le retour rapide.
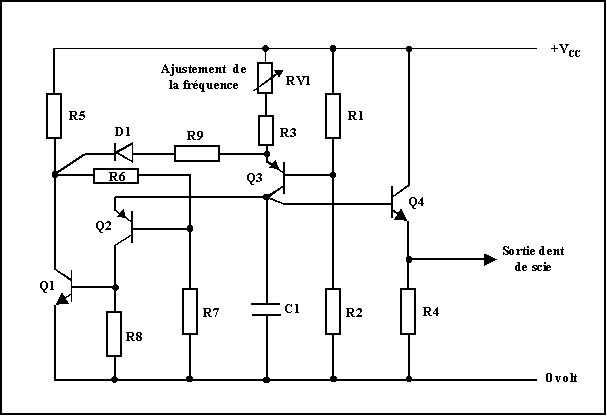
Ce circuit est un générateur qui assure une bonne linéarité des dents de scie au moyen d'une source à courant constant. Il se compose de trois ensembles. Q3 est la source de courant constant qui débite un courant de charge constant à la capacité C1; Q1 et Q2 constituent une porte rapide pour la décharge de C1, Q4 est un émetteur suiveur jouant le rôle d'amplificateur présentant une faible impédance de sortie.
Exemple :
Soit Vcc = 12 Volts, R1 = 4K7, R2 = 15K, R3 = 2K2, R4 = 10K, R5 = 1K, R6 = 2K2,
R7 = 15K, R8 = 2K2, R9 = 1K5, RV1 = 1K et C1 = 2.2 µF et examinant tout d'abord la source à courant constant.
La base de Q3 a son potentiel aux alentours de 9 Volts (diviseur R1-R2). Le potentiel d'émetteur est de 9.7 Volts; on a donc une chute de tension de 2.3 Volts aux bornes de la résistance R3+RV1; si cette dernière résistance est ajustée à 2.68 K , le courant s'écoulant dans le transistor sera alors de 858 µA et restera à cette valeur pour une variation importante de la tension collecteur-émetteur du transistor. La tension sur l'émetteur de Q2 augmente au fur et à mesure que C1 se charge, la tension sur sa base étant fixée à 5.8 Volts par le diviseur R5-R6-R7. Lorsque cette tension atteint 5.8+0.7 Volts, Q2 se sature de même que Q1 et le condensateur C1 se décharge.
Pendant la décharge de C1, le collecteur de Q1 est à 0 Volt, la diode D1 conduit et coupe la source à courant constant. C1 déchargé, les transistors Q1 et Q2 sont à nouveau bloqués et le cycle recommence.
Comme Q = CV
et Q = it
on en déduit que le temps de charge pour atteindre le potentiel V (ici de 6.5 Volts) est :
t = CV / i = 2.2µF x 6.5 V / 858 µA = 16.67 ms
L'étage de sortie est un amplificateur de puissance à signaux forts qui va fournir un courant suffisant aux bobines verticales.
8.3.3. Dispositifs auxiliaires :
Un certain nombre de dispositifs auxiliaires sont nécessaires pour assurer un bon fonctionnement des circuits de balayage.
Commande de stabilité verticale : elle fait varier la fréquence libre de l'oscillateur vertical. La régler juste au dessous de 60 Hz pour que les tops de synchronisation verticale verrouillent l'oscillateur et stabilisent l'image.
Commande de linéarité : elle fait varier la linéarité des dents de scie. La régler pour éliminer la compression ou l'expansion des lignes de balayage au sommet ou au bas de l'image. Le perfectionnement du circuit de déviation a permis d'éliminer la commande de linéarité verticale
Commande de hauteur d'image : elle fait varier la sortie de l'amplificateur vertical. La régler pour remplir l'écran de haut en bas de lignes de balayage.
8.4. Base de temps horizontale :
Cette partie du téléviseur est encore appelée base de temps lignes. La base de temps horizontale a pour mission d'assurer le déplacement, par l'intermédiaire des bobines de déviation lignes, du faisceau d'électrons ligne par ligne, et de gauche à droite pendant le temps d'aller où le faisceau est modulé par les signaux vidéo. Pendant le retour, le faisceau est "coupé".
On profitera des surtensions produites lors du retour de lignes pour réaliser l'alimentation T.H.T. (très haute tension) nécessaire au tube-images.
8.4.1. Schéma bloc
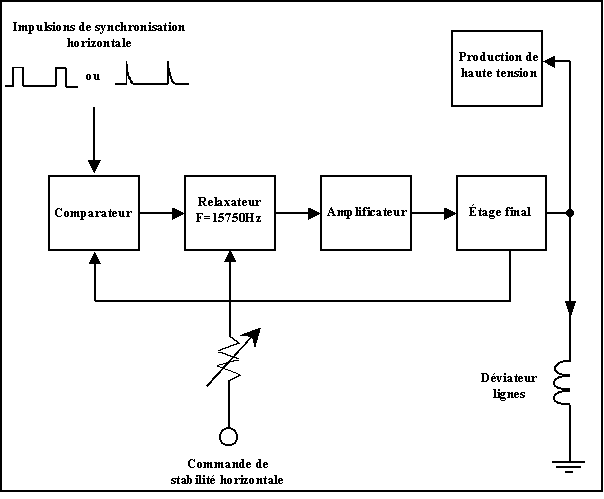
8.4.2. Fonctionnement :
Le principe de fonctionnement est fondamentalement analogue à celui du balayage vertical mais en raison de la fréquence plus élevée dans le balayage horizontal, il comporte quelques différences importantes :
La base de temps horizontale comporte un comparateur de phase qui va fournir une tension de correction continue qui va commander la fréquence de l'oscillateur. Le comparateur est nécessaire car une variation de phase dans les signaux de synchronisation ou dans ceux de l'oscillateur lignes perturbe le balayage de sorte qu'il risque de manquer des lignes dans l'image, l'effet étant analogue à celui des "déchirures".
soit un écran de dimensions L = 66 cm (26'') et H = 49.5 cm (19.5'').Exemple :
Le balayage lignes permet d'explorer une ligne (66 cm) en (durée totale d'une ligne - durée de retour ligne) 53.3 µs soit 1.24 cm en 1µs.
Le balayage trames explore la hauteur soit 49.5 cm en (durée d'une trame - durée de retour trame) en 15.34 ms soit 0.003 cm en 1 µs
Ce simple calcul permet de faire la conclusion suivante : une erreur de 1 µs due à des parasites de courte durée dans la base de temps horizontale correspond à un déplacement horizontal de 1.24 cm provoquant des déchirures de l'image dans le sens horizontal. La même erreur dans la base de temps verticale se traduit par un déplacement vertical de 0.003 cm qui n'a pratiquement aucun effet. Pour cette raison, la base de temps horizontale nécessite un comparateur de phase.
La sortie horizontale est appliquée au transformateur haute tension (flyback) qui produit la tension anodique du tube-images. Sans le balayage horizontal, l'écran n'est pas lumineux.
La sortie du comparateur est une tension de correction continue. Elle indique si la fréquence de l'oscillateur est correcte. Si la fréquence est trop grande ou trop petite, une tension de correction continue sera produite pour amener l'oscillateur à la fréquence des tops. On a donc affaire à un système à boucle à verrouillage de phase appelée commande automatique de fréquence horizontale (CAFH) dans ce cas précis.
Étage final : c'est un amplificateur de puissance qui va appliquer le courant de balayage horizontal directement aux bobines. Il est précédé d'un autre amplificateur qui est un étage d'attaque (driver).
8.4.3. Production de la haute tension :
Le circuit de sortie horizontale comporte six éléments importants :
Le transistor de sortie horizontale (Q1) "Horizontal Output Transistor" HOT
Le transformateur THT "flyback transformer" (flyback)
Le condensateur de sécurité ou de correction en "S" "retrace timing capacitor or safety capacitor" Ct
La diode d'amortissement "damper diode" D1
Le déflecteur horizontal "horizontal yoke"
Le condensateur de retour en série avec le déflecteur "yoke series capacitor" Cs
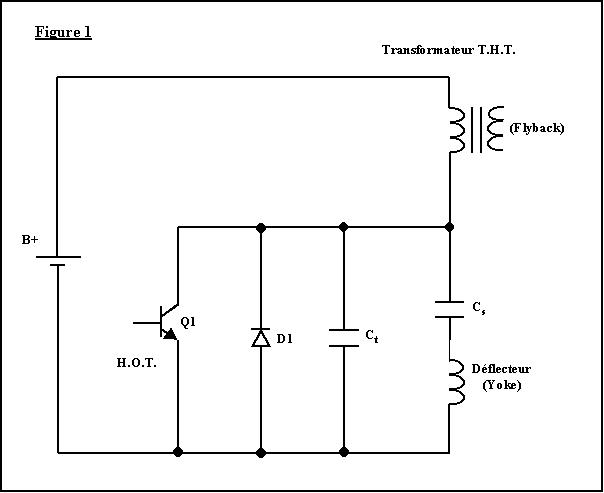
La figure 1 montre un schéma simplifié d'un étage de sortie horizontale avec ses six éléments clés. Le transistor Q1 est polarisé avec une tension B+ qui passe à travers du primaire du transformateur T.H.T. (flyback). Dès qu'il est polarisé, l'étage de sortie horizontale commute entre deux circuits résonants LC. Ces circuits résonants sont formés par le transformateur T.H.T., le déflecteur et les condensateurs de l'étage horizontal.
Les courants alternatifs dans l'étage produisent des signaux en dents de scie (sawtooth) dans le déflecteur et dans le primaire du transformateur.
Les dents de scie vont créer un champ magnétique qui va permettre de dévier le faisceau d'électrons du tube image pour faire l'analyse de l'image.
Le transistor sert de commutateur. Il ouvre à la fréquence horizontale soit 15750 Hz (T=63.5 µs). Quand il est fermé (ON), il présente une faible résistance (inférieure à 5 ohms) pour les courants du transformateur et du déflecteur. Quand il est ouvert (OFF), aucun courant ne le traverse (il présente une résistance émetteur-collecteur supérieure à 10 M ).
Il faut remarquer qu'il n'y a aucune tension DC sur la base du transistor. Il devient passant lorsqu'un signal est appliqué entre sa base et son émetteur.
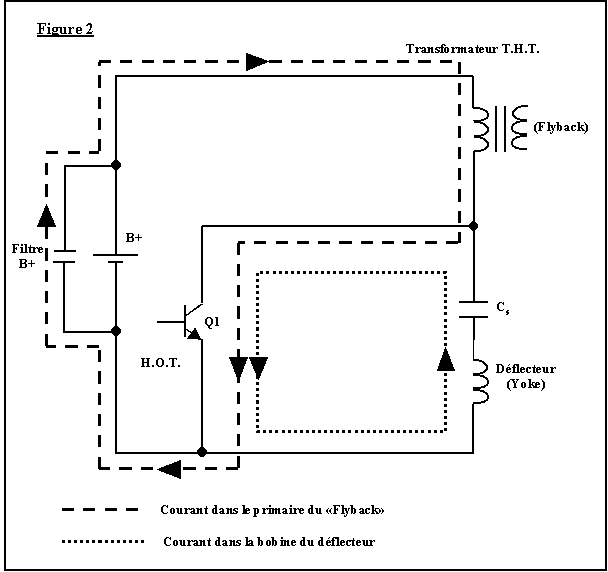
* Principe de la production de la haute tension :
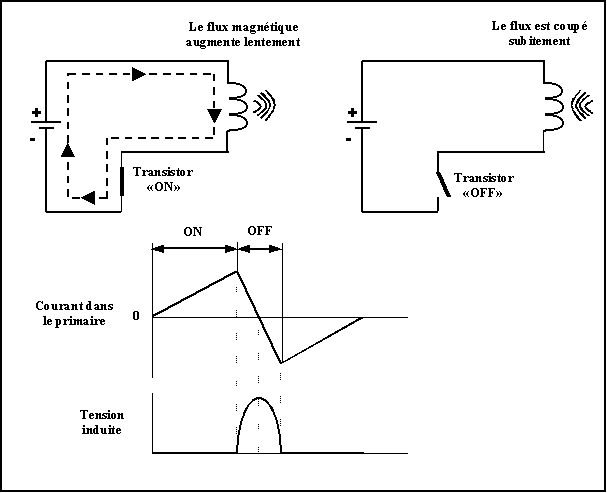
Selon les dimensions et le type du tube-images, la T.H.T. nécessaire varie grosso modo entre
3 KV et 25 KV. Pour obtenir cette T.H.T., on met à profit les surtensions apparaissant aux bornes du bobinage primaire d'un transformateur (flyback) lorsqu'on coupe le courant qui le parcourt. Des oscillations prennent alors naissance aux bornes du bobinage secondaire; elles sont ensuite redressées et filtrées.
* Courant dans le flyback -1e temps- (transistor "ON")
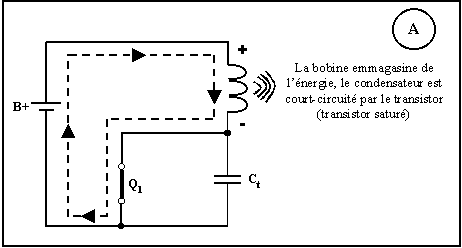
* Courant dans le flyback -2e temps- (transistor “OFF”)
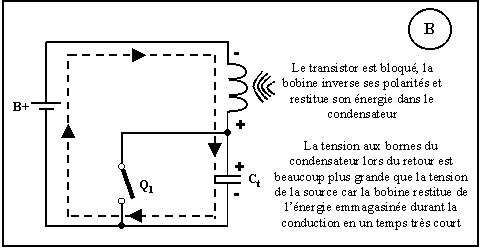
* Courant dans le flyback -3e temps- (transistor “OFF”)
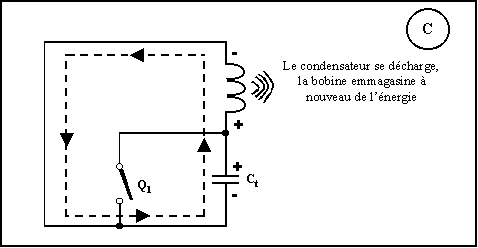
* Courant dans le flyback -4e temps- (diode “ON”)
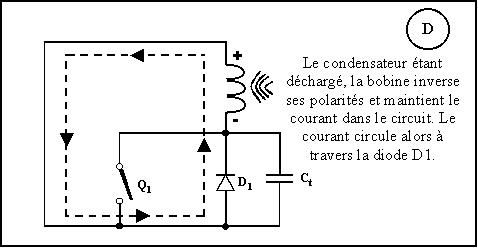
* Les formes du courant dans le primaire du transformateur T.H.T. et de la tension aux bornes du condensateur Ct sont les suivantes :
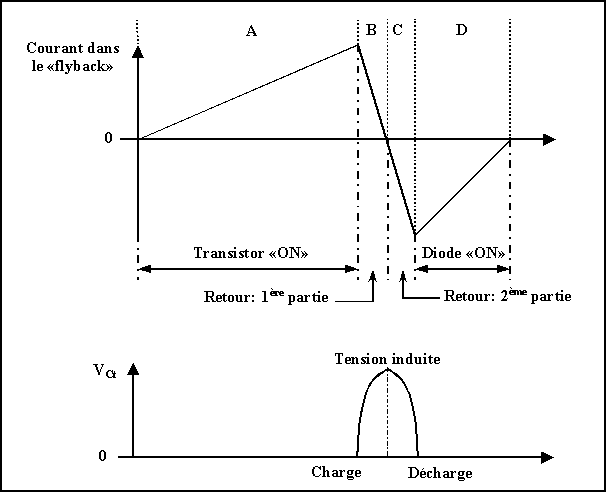
* Tensions auxiliaires : Diverses tensions sont fournies par les enroulements supplémentaires du transformateur "lignes" ou flyback. Ces tensions vont servir à :
. la polarisation grille-cathode du tube-images
. la polarisation de la grille d'accélération G2
. l'alimentation de l'étage vidéo de puissance
. la tension de syntonisation (tuning)
. l'alimentation du filament de chauffage du tube-images
8.4.4. Courant dans le déflecteur : Cs s’est chargé par le B+ durant le blocage du transistor.
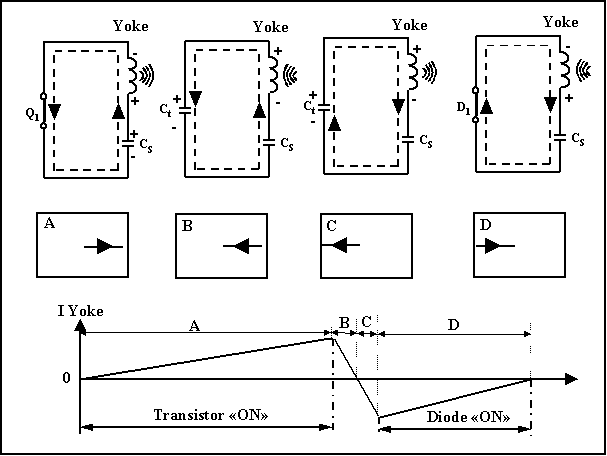
8.5. Différence de comportement entre les bobines "lignes" et les bobines "trames" :
On conçoit intuitivement que le rendement sera d'autant meilleur que le nombre de tours des bobines sera plus grand, puisque le champ est directement proportionnel au nombre d'ampère-tours (F = NI).
En d'autre termes, pour une même déviation, l'intensité à fournir est d'autant plus élevée que le nombre de tours est plus faible. Malheureusement, un grand nombre de tours signifie une inductance plus élevée et, par suite, une constante de temps importante, qui peut être incompatible avec les valeurs adoptées dans les bases de temps (TH = 63.5 µs et TV = 16.67 ms).
Rappelons que pour les bobines, la constante de temps est donnée par t = L / R.
Dans le cas du balayage horizontal, le temps de retour est de quelques microsecondes seulement, et les bobines devraient donc avoir une inductance de quelques microhenrys c'est à dire un faible nombre de tours. Par conséquent, il faut fournir une intensité très importante aux bobines pour créer le champ nécessaire.
Bobines horizontales : elles ont moins de tours de fil. Elles ont une résistance plus faible et nécessitent plus d'intensité (Résistance inférieure à 1 ohm).
Bobines verticales : elles ont un plus grand nombre de tours de fil, elles nécessitent moins de courant et présentent une résistance plus grande (Supérieure à 5 ohms).